Entre 2017 et 2019, les photographes Cécile Cuny, Hortense Soichet et Nathalie Mohadjer ont sillonné la France et l’Allemagne pour nous ouvrir les portes des entrepôts de logistique. Le résultat de ce travail au long cours est une expo instructive et humaniste, à découvrir jusqu’au 20 septembre à la Maison de la photographie Robert-Doisneau, à Gentilly (Val-de-Marne).

Ils et elles s’appellent Didier, Weheb, Manuella, Maximilien, Sylvie, Moussa, Olivier, Franziska, Nina, Mostafa et Santa. Et ont entre 28 et 56 ans. Ils et elles sont manutentionnaires, préparateur·rices de commandes ou intérimaires dans la logistique. Depuis quelques mois pour certains ou trente ans pour d’autres. Ces ouvriers et ouvrières de la logistique, d’ordinaire invisibles, sont mis en lumière dans l’expo « On n’est pas des robots, ouvrières et ouvriers de la logistique », jusqu’au 20 septembre à La Maison de la photographie Robert-Doisneau de Gentilly (Val-de-Marne).
Cette expo repose sur une enquête sociologique et photographique menée pendant trois ans par les photographes Cécile Cuny, Hortense Soichet et Nathalie Mohadjer en France et en Allemagne. Elle nous dévoile les coulisses des entrepôts de la logistique. La logistique désigne toutes les activités d’entreposage et de préparation de commandes destinées à la grande consommation et à l’industrie. Le secteur représente 17 % des emplois en Allemagne – où il est le premier employeur d’intérimaires (21,7 %) – et 13 % des emplois en France – où il est le deuxième recruteur d’intérimaires (12,2 %).
Les trois photographes ont étudié quatre entrepôts : trois qui alimentent les supermarchés et les grands magasins et un qui approvisionne un fabricant de panneaux solaires. La présentation de leur enquête, organisée sur deux étages, est une plongée passionnante dans un secteur dont on entend parler qu’à coups de scandales Amazon, mais qui a encore montré son utilité pendant le confinement.
À l’origine de cette exposition, Cécile Cuny, photographe, sociologue et maîtresse de conférence à l’École d’urbanisme de Paris (EUP), explique à Causette la genèse du projet.
Causette : D’où vous est venue l’idée de cette expo ?
Cécile Cuny : Le point de départ était d’étudier le monde ouvrier en prenant le contrepoint des discours sur la désindustrialisation et la disparition de cette classe de travailleurs. C’est comme ça que j’ai découvert la logistique… Je voulais montrer que, certes, des usines ont été délocalisées, mais la logistique s’est développée en parallèle. Car, à un moment, on a besoin de faire revenir cette marchandise, qu’il faut donc gérer. L’idée était donc de travailler sur ce qu’on appelle en sociologie la recomposition des mondes ouvriers, selon laquelle ces mondes n’ont pas disparu, mais sont redistribués sur d’autres activités. La logistique est rattachée au tertiaire, mais quand on regarde de plus près, l’organisation du travail y reste celle d’un monde très industrialisé.
Comment avez-vous procédé pour réaliser ce travail d’enquête photographique ?
C. C. : Ce projet devait se dérouler sur quatre villes, en France (Marne-la-Vallée et Orléans) et en Allemagne (Kassel et Dietzenbach, respectivement au nord et au sud de Francfort). J’ai donc décidé de le réaliser en collectif, avec Hortense Soichet et Nathalie Mohadjer. On était trois photographes, aidées de sociologues et de biographes. La photo est une manière d’entrer sur le terrain. Avec Hortense, nous avons commencé par une observation des zones d’activité, qui concentrent les entrepôts à la périphérie des villes. C’est la première partie de l’expo, au rez-de-chaussée, où l’on découvre les portraits de ces zones logistiques. Cette méthode est intéressante parce qu’elle nous a inscrites dans l’espace, nous qui débarquions avec nos trépieds dans cet univers très masculin où d’ailleurs, aucun piéton n’y a sa place. C’était déroutant… On pensait même que ce serait monotone, mais ça ne l’était pas du tout. Hortense a photographié toutes les rues de chaque zone avec différents points de vue. Elle a également réalisé une immersion dans un entrepôt de livres, qui a donné toutes les images de l’intérieur. Je me suis concentrée sur les façades d’entrepôts, mais aussi des linéaires de rues où il y a toujours une trace de la logistique. Nathalie a une approche plus intuitive, elle a fait des photos de détails à découvrir aussi au rez-de-chaussée. Lors de cette première phase, la photographie nous a aidées à nous positionner dans l’espace de notre sujet et nous l’approprier.
Dans un deuxième temps, nous avons négocié avec les entrepôts des entretiens avec les ouvrières et ouvriers rencontré·es pour pénétrer leur lieu de travail. On leur a proposé ensuite des itinéraires photographiques scénarisés, qui fonctionnent comme une série de portraits : on les a suivi·es sur différents lieux, trajet domicile-travail par exemple ou d’autres en lien avec l’histoire qu’ils et elles nous ont racontée. C’est la troisième étape de ce travail et la seconde partie de l’expo, située à l’étage. Grâce à la photographie, on propose un récit en images et avec du texte, qui recontextualise.
Les patrons comme les ouvriers vous ont-ils facilement ouvert les portes de ces entrepôts ?
C. C. : Cela a été long à négocier : entre six et dix-huit mois selon les entrepôts pour obtenir leur accord, et ce, à condition de garantir l’anonymat : les entreprises ne sont donc pas citées et les salarié·es identifié·es uniquement par leur prénom. En revanche, ils et elles ont validé le choix des images et des textes. Notre seule crainte était de passer pour des agents de la direction, mais tout s’est joué dans l’interaction des entretiens. Je précise que ces entretiens étaient dédommagés. C’était une demande des syndicats allemands, que nous avons jugée juste, dans la mesure où les employé·es devaient échanger avec nous, une heure ou plus après leur journée de travail. Nous avons donc mis en place le dédommagement dans les autres entrepôts aussi. Cela a facilité la participation des ouvrières et ouvriers à l’enquête, mais ce n’était pas la principale motivation. L’intérêt qu’on portait à leurs métiers était également apprécié. Ce sont les intérimaires qui ont parlé le plus librement, je pense par exemple à l’entrepôt de Marne-la-Vallée, parce qu’ils ont un rapport différent à l’entreprise : ils savent qu’ils ne resteront pas.
Quel est le profil de ces salariés ? Comment expliquez-vous le monopole de l’intérim ?
C. C. : Dans les entrepôts que nous avons étudiés, les intérimaires représentent entre 30 et 50 % du personnel. Les entrepôts de Marne-la-Vallée et Dietzenbach sont très féminisés, avec plus de 50 % de main‑d’œuvre féminine. Mais, cette féminisation est plutôt un indicateur de mauvaises conditions de travail. Les femmes sont embauchées sur les tâches les moins valorisées et les moins bien rémunérées. En outre, elles ont plus de contraintes pour accéder au marché de l’emploi. Si je prends l’entrepôt de Marne-la-Vallée, beaucoup de femmes intérimaires considéraient le travail dans la logistique comme un salaire d’appoint, le revenu principal restant celui du conjoint. Ce qui compte pour elles, c’est que leur poste soit à proximité de leur domicile. Cela concerne d’ailleurs des femmes de nationalité étrangère (il y avait des Africaines, mais aussi des Bulgares), qui parlent de discrimination ou d’importantes difficultés dans les secteurs pour lesquels elles ont été formées, et qui se rabattent sur ces métiers plus facilement accessibles. Bien sûr, cela ne reflète pas toutes les situations… Les directeurs de ces deux entrepôts, eux, justifient cette féminisation par leur organisation du travail. Selon eux, ils traitent essentiellement des vêtements sur cintres, avec des tâches liées au pliage et à l’étiquetage, il leur faut donc des personnes soigneuses, des femmes. Mon avis est que leur politique de recrutement privilégie certains groupes sociaux qu’ils vont simplement pouvoir moins payer. En plus, comme on est sur de la semi-mécanisation, l’organisation du travail est adaptée à cette main‑d’œuvre. À Kassel, c’est tout l’inverse. La main‑d’œuvre est plus régulière, plus masculine et plus âgée. Les postes de travail y sont aménagés, donc les conditions de travail plus valorisées et les salaires plus attractifs.
Pourquoi ce titre « On n’est pas des robots qui » évoque l’automatisation de ces métiers ?
C. C : Ce titre évoque bien sûr les mauvaises conditions de travail, avec de bas salaires, sans prime de productivité, des missions très courtes de trois à quatre semaines en moyenne, etc. Certes, il n’y a pas de robot, mais on parle aussi de la semi-mécanisation. Les travailleuses et travailleurs ne cessent de répéter : « On n’est pas des robots » dans le sens « on est des humains, arrêtez de nous imposer des rythmes intenables ».
Quel regard les municipalités portent-elles sur ces entrepôts qu’elles accueillent ?
C. C : Les municipalités ne connaissent pas bien cette activité. Ce qui les intéresse, c’est le développement économique. Et cela coûte très cher en aménagement. Or, les développeurs immobiliers proposent des projets clés en main, avec comme promesse x emplois créés. Pour les maires, c’est du pain béni. Leur seule préoccupation a été, dans les années 1990, l’impact environnemental. Pour eux, un entrepôt signifie beaucoup de camions, donc des nuisances. C’est par exemple le cas à Dietzenbach. Lors de nos échanges avec la municipalité, ils nous ont expliqué que non seulement les riverains n’en pouvaient plus, et qu’en outre, la mairie devait refaire les routes tous les cinq ans. Dans les nouvelles zones logistiques, les maires élaborent un ensemble de réglementations afin de s’assurer une logistique avec moins de camions.
Qu’avez-vous découvert de marquant dans vos recherches ?
C. C : Ce qui m’a beaucoup marquée, c’est la segmentation de la main‑d’œuvre. Qu’elle soit entre salariés et intérimaires ou liée au genre.
Quel message voulez-vous que le public retienne de cette expo ?
C. C : Eh bien, celui des salarié·es : « On n’est pas des robots. » Car c’est aussi un message critique vis-à-vis de l’ensemble du capitalisme. On l’a vu avec le confinement. C’est sûr, les conditions de travail ne sont pas bonnes, on peut toujours essayer de les améliorer. Mais à la base, le problème, c’est surtout de faire venir les marchandises de trop loin. C’est tout notre système productif qui nous fait marcher sur la tête et qui, finalement, déshumanise les salarié·es. Et c’est valable jusqu’au consommateur.
En images
Emmy-Noether-Strasse, côté pair. Observatoire photographique de la zone d’activités GVZ-Kassel, juillet 2017 © Cécile Cuny
Uwe (Felsberg-Melsungen), 6 décembre 2017. Diaporama (extrait), 15 minutes
© Cécile CunyZone Industrielle Dietzenbach Nord, Allemagne 2017
© Nathalie Mohadjer
Zone Industrielle Dietzenbach Nord, Allemagne 2017
© Nathalie Mohadjer
Zone Industrielle Dietzenbach Nord, Allemagne 2017
© Nathalie Mohadjer
Itinéraire avec Maximilien, région parisienne, 2018
© Hortense SoichetItinéraire avec Manuella, région parisienne, 2018 © Hortense Soichet

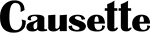




[…] Causette (interview avec Cécile Cuny) […]