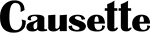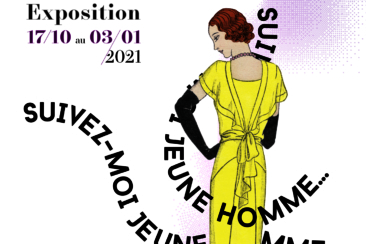Avec Vivre pour les caméras, ce que la téléréalité à fait de nous (JC Lattès), la journaliste indépendante Constance Vilanova signe un essai percutant sur un objet audiovisuel longtemps mis de côté par les médias, alors qu’il creuse pourtant toutes les failles de notre société depuis plus de vingt ans.
Pendant longtemps, Constance Vilanova, 30 ans, a entretenu un rapport intime à la téléréalité. La journaliste indépendante en consommait presque quotidiennement à l’heure du goûter, jusqu’au jour où une contradiction intérieure et une prise de conscience féministe sont venues tout bousculer. Comme d’autres, Vilanova s’est rendu compte que depuis plus de vingt ans, la téléréalité a été le terrain de la banalisation de la culture du viol, de la romantisation de la masculinité toxique, tout comme le théâtre de multiples violences sexistes et sexuelles. Et pourtant. Pendant près d’un quart de siècle, les médias dits traditionnels ne se sont pas intéressés à la question, trop populaire, trop scandaleuse, pas assez intelligente, laissant ainsi prospérer un far-west du patriarcat alimenté par la presse à scandale.
Il a fallu attendre des enquêtes journalistiques récentes et la libération de la parole de plusieurs candidates sur les violences qu’elles ont vécues pour qu’un #MeToo de la téléréalité commence à pointer finalement le bout de son nez. Après avoir elle-même signé plusieurs enquêtes et chroniques sur le sujet, Constance Vilanova vient de publier un essai passionnant, Vivre pour les caméras, ce que la téléréalité a fait de nous, chez JC Lattès. Entretien.
Causette : Vous venez de publier un récit à la première personne dans lequel vous racontez, en fil rouge, votre propre rapport à ces programmes. Pourquoi ce choix ?
Constance Vilanova : L’exercice de la chronique ou de l’enquête ne permet pas d’analyser ce rapport très intime à la téléréalité alors que la consommation de ces programmes a été constitutive de la trentenaire que je suis désormais.
L’idée n’était pas de faire une somme de tous les papiers que j’avais pu écrire mais de proposer une sorte d’objet littéraire un peu hybride à mi-chemin entre l’enquête journalistique et le récit autobiographique pour pouvoir montrer à quel point la téléréalité a des conséquences sur l’intime.
Quelles conséquences a‑t-elle eues sur votre propre intimité ?
C.V. : La téléréalité a modifié ma façon de voir l’amour. Elle a fait de moi une femme qui attend de la passion en permanence, qui va vouloir qu’on s’engueule, qu’on crie, qui va lever le ton pour pas grand-chose. La téléréalité va aussi me faire percevoir le mariage comme une mise sous clé de l’autre, il permettrait à l’homme de ne plus partir. Et en dehors du couple, il y a aussi la question de la rivalité féminine. J’ai longtemps vu les femmes autour de moi, particulièrement quand j’étais ado, comme des compétitrices, des ennemies. Je les voyais comme des rivales qui passaient leur temps à chercher les faveurs des hommes avec qui elles interagissaient. Avec elles, je me voyais dans un duel où la sororité n’existe pas. C’est quelque chose qu’on voit beaucoup dans la téléréalité : les candidates sont mises en compétition en permanence. On l’a vu dès le Loft en 2001 [première émission d’enfermement en France, nldr] avec Loana, la bimbo blonde, contre Laure, la bourgeoise brune. Cette opposition m’a malheureusement écartée longtemps de la sororité, alors même que c’est cette sororité qui m’a sauvée après mon agression sexuelle en 2019.
Lire aussi I Féminisme et téléréalité : la synergie est-elle possible ?
Quand avez-vous changé votre regard sur ces programmes ?
C.V. : Mon regard sur les candidates a changé lorsque j’ai vécu une agression sexuelle, en 2019. Ça m’a énormément affectée et ça a vraiment changé ma lecture du monde. En en parlant avec des amies, je me suis rendu compte qu’on avait toutes, peu importe le milieu social, était victimes de violences sexistes et sexuelles. Je me suis aussi rendu compte que les candidates de téléréalité avaient commencé à parler de ce qu’elles vivaient sur les tournages, de l’omerta qu’elles subissaient, des contrats qui les empêchaient de parler ou de dénoncer tel ou tel candidat, mais qu’on ne les avait pas écoutées parce qu’elles étaient de “mauvaises victimes”, qu’elles venaient de milieux sociaux défavorisés et qu’elles participaient à des programmes assortis d’une aura très négative. Ça m’a un peu sauté au visage à ce moment-là. Je me suis rendu compte que les médias n’avaient pas fait leur boulot.
La téléréalité a‑t-elle influencé chacun de nous, même les personnes qui n’en ont jamais regardé ?
C.V. : Oui, parce que c’est un genre audiovisuel qui a inondé tous les autres. Quand on regarde aujourd’hui un débat politique, je considère qu’on regarde un peu une téléréalité, avec une recherche du clash et de la punchline en permanence. Idem quand on regarde un documentaire criminel, on retrouve des codes de la téléréalité comme le confessionnal, un face caméra de l’interlocuteur. Au-delà de la forme, le fond de la téléréalité a aussi influencé notre société. Les candidats et les candidates ont souvent des millions d’abonnés sur leurs réseaux sociaux où ils continuent les clashs. Et qu’on les suive ou non, leur discours a un impact sur nous. Par exemple, la vidéo où Jessica Thivenin et Thibault Garcia expliquent que Jessica se force à faire l’amour avec Thibault a circulé partout. Personne n’y a échappé.
Autre influence selon moi, la mise en scène de nous-mêmes. Avant, on ne se filmait pas en pleurant par exemple. Alors qu’aujourd’hui, de plus en plus de jeunes se filment chaque jour tout au long de leur post-rupture amoureuse, pour en faire ensuite un montage. Avec son smartphone, on peut nous-mêmes créer la téléréalité que l’on veut et se mettre en scène comme un candidat.
La téléréalité serait donc finalement un laboratoire d’analyse de notre société ?
C.V. : Selon moi, c’est un miroir grossissant où tout est exacerbé. Le discours sexiste premièrement : les injonctions qui pèsent sur les femmes sont exacerbées, on le voit avec la chirurgie esthétique, des corps ultra botoxés et des visages clonés. On note aussi l’importance du couple et du mariage qui est omniprésente dans la téléréalité. Une candidate, une femme, ne peut pas évoluer seule. Il faut qu’elle soit en permanence en couple pour exister à l’écran, sinon elle se fait évincer par la production. Faire un enfant permet ensuite d’en faire un nouveau produit, une nouvelle téléréalité [comme l’émission, Carla + Kevin = bébé Ruby, diffusée en replay sur M6 en 2019].
La téléréalité est également un objet à l’intersection de plusieurs luttes : du racisme, parce qu’on est sur des castings entièrement blancs et qu’on estime que les femmes noires n’ont pas accès à l’amour romantique. De l’homophobie et de la lesbophobie : il y a seulement eu trois couples lesbiens en vingt ans et l’homosexualité représentée est assez stéréotypée. Et pour finir, la lutte des classes puisqu’on parle d’une industrie qui capitalise sur le mépris de classe et le mépris social depuis deux décennies.
Pendant longtemps, la téléréalité a été méprisée médiatiquement. Les médias traditionnels s’y intéressent en 2001, avec la naissance de l’ovni télévisuel qu’est le Loft et puis plus rien. Seuls les médias “à scandale” ou les blogueurs comme Jeremstar ou Aquababe parlaient de ce qu’il se passait au sein des programmes. D’où vient ce manque d’intérêt pour le sujet ?
C.V. : Les rédactions institutionnelles ont vraiment délaissé ce secteur parce qu’il était clairement associé à la télé-poubelle et aux “beaufs”. Un snobisme qui s’explique par le fait que le milieu du journalisme en France est généralement composé de classes sociales supérieures. Il y a très peu de journalistes racisés ou de boursiers par exemple. Ce manque de diversité a fait de ces programmes un angle mort médiatique par mépris et par snobisme.
La téléréalité est aussi assez hermétique. Il y a tout un langage et des codes à apprivoiser. Et quand on ne les connaît pas, il peut y avoir un effet répulsif.
Quand j’ai proposé des enquêtes sur le sujet au début des années 2020, j’ai eu affaire à des petites remarques sexistes de la part de rédacteurs en chef masculins. Il y a aussi un manque d’intérêt scientifique. On peut citer les travaux de la sociologue Nathalie Nadaud-Albertini, l’essayiste Valérie Rey-Robert, la sociologue et autrice Illana Weizman ou encore la doctorante Maureen Lepers, mais c’est assez récent. En discutant avec elles, on se rend très vite compte que leur matière scientifique est dénigrée par leurs pairs. Elles ont du mal à être prises au sérieux par leurs confrères et consœurs. La téléréalité ne sera jamais un objet légitime.
Le manque d’intérêt des médias traditionnels pour la téléréalité a‑t-il eu pour conséquence le passage sous silence des violences sexistes et sexuelles (VSS) et, plus largement, des dérives de ces programmes ?
C.V. : Comme ça a été un angle mort médiatique pendant vingt ans, les parents n’ont pas été alertés, les profs non plus. Il n’y avait pas de médias pour alerter et dire : “Attention les programmes que regardent vos enfants depuis vingt ans sont très sexistes et prônent la culture du viol à l’heure du goûter.” Que des jeunes femmes soient agressées sexuellement sur des tournages, que la culture du viol soit tous les jours à l’antenne à 17 h 30, ça n’a pas intéressé les médias.
Lire aussi I Alix Desmoineaux brise l’omerta des violences sexuelles dans le milieu de la téléréalité
En 2021, quatre ans après #MeToo, on a vu timidement apparaître le #Metoo de la téléréalité lorsque Illan Castronovo est mis en cause pour des agressions sexuelles et du harcèlement par au moins cinq candidates de téléréalité. Il est aussi accusé de viol par deux femmes après une soirée dans une boîte de nuit du Loir-et-Cher. En mars 2023, Hilona Gos raconte les violences physiques et psychologiques de son ex-compagnon, Julien Bert. Pour autant, on n’a pas assisté à une déferlante de témoignages. Pourquoi le #MeToo de la téléréalité ne prend pas ?
C.V. : Parce que la téléréalité est un milieu très “consanguin”. Pointer du doigt un candidat, c’est se mettre à dos une boîte de production. Endemol appartient par exemple à Banijay, donc tout le monde se connaît, les producteurs, les cameramen, les cadreurs… Il y a une omerta telle que les candidats ne peuvent pas raconter tout ce qu’il se passe sans prendre le risque d’être “grillés”.
Le #MeToo de la téléréalité aura-t-il lieu un jour ?
C.V. : Tant que cette industrie continuera de capitaliser sur la détresse de jeunes femmes vulnérables, cela sera compliqué. C’est aussi très difficile de sortir de ce milieu. C’est un milieu qui tachequand on veut chercher du travail et qu’on a, à son actif, plusieurs tournages. Donc, quand on te propose un autre tournage, tu dis facilement oui. La libération de la parole prendra beaucoup de temps.
Et quand elles parlent publiquement des abus et des violences qu’elles subissent, les candidates ne sont pas vues comme des “bonnes victimes”.
C.V. : Oui, elles ont participé à des programmes qui sont très mal vus, donc il y a ce jugement : “Elles n’avaient qu’à pas y aller.” Ce sont aussi des victimes dont le corps est leur instrument de travail. C’est dur pour elles, car elles sont sans cesse jugées sur leur façon de se mettre en scène sur les réseaux. Cela va justifier le fait que ce sont des mauvaises victimes auprès de certains.
Les candidats masculins ont d’ailleurs eux-mêmes du mal à s’engager et à dénoncer publiquement les violences sexistes et sexuelles…
C.V. : Les masculinités dans la téléréalité restent très toxiques et très virilistes. Les candidats vont toujours sauver leurs copains. Lorsque Adrien Laurent a été accusé de violences sexuelles [une plainte a été déposée contre lui en mars 2024], il a tout de suite été soutenu par Illan Castronovo, lui-même mis en cause pour des violences sexuelles. C’est très rare que les hommes prennent position en faveur des femmes victimes. Certains l’ont fait comme Antoine Goretti, mais il n’a fait qu’une seule téléréalité, donc c’est aussi plus facile pour lui de le faire.
Lire aussi I “J’adore les femmes, le sexe, mon but c’est de les ouvrir” : la téléréalité de l’enfer “Frenchie Shore” débarque sur MTV
Ces dernières années, on a d’ailleurs pu lire dans la presse généraliste plusieurs enquêtes sur les VSS dans la téléréalité. Les choses ont-elles changé depuis ?
C.V. : Les productions ont rallongé les temps de casting. Elles ne peuvent plus se permettre de ne pas se rencarder sur le casier judiciaire des jeunes hommes qu’elles vont faire entrer dans une aventure. Elles sont aussi obligées de leur faire passer un test psychologique. Elles essaient maintenant de faire mieux. Dans Frenchie Shore, qui reste une émission de plateforme déconseillée aux moins de 18 ans, un candidat a embrassé un autre candidat sans son consentement. L’auteur en question a fait un tweet lors de la diffusion de l’épisode en disant qu’il s’agissait d’une agression sexuelle et a tout de suite présenté ses excuses. Donc on voit bien que le discours change depuis que les médias s’en sont emparés.
Il y a aussi une évolution dans le concept. C’est fini, les téléréalités sans enjeu, sans stratégie comme Les Marseillais. Je pense que le public en a marre du recyclage permanent des mêmes profils et des mêmes concepts. On voit aujourd’hui de la téléréalité beaucoup plus bienveillante, à l’image de la nouvelle saison de Secret Story [diffusée sur TF1 depuis le mois d’avril et produite par Endemol, qui a promis une “forteresse safe familiale”] qui est en totale opposition avec toutes les précédentes.
Comme la Star Academy, dont la dernière saison a fait un carton sur TF1 en partie grâce à cette bienveillance ?
C.V. : J’ai mis de côté la Star Academy pour ce livre, car c’est un télé-crochet avec un enjeu musical, mais oui, Endemol a également construit cette saison en opposition aux saisons précédentes. Dans la première mouture, diffusée fin 2001, on se souvient par exemple du sexisme dans le portrait de Jenifer, où ses mensurations étaient indiquées. Tandis que dans la dernière saison, la prof de chant demandait l’autorisation aux élèves avant de leur toucher le ventre.
Mais c’est aussi un coup de communication, car l’enjeu pour les productions est de récupérer la case porteuse de 17 h 30, la case dite “after school”, qui doit être impeccable niveau contenu pour éviter la signalétique “moins de 12 ans”.
Les productions font très attention désormais à avoir des castings plus lisses, qui ne ressemblent pas aux castings qu’on voyait auparavant. Dans Secret Story, par exemple, peu de jeunes femmes ont visiblement fait de la chirurgie esthétique. C’est d’ailleurs un des arguments de la production et elle le dit de manière assez méprisante.
Pourtant, à l’hiver 2023, on a vu apparaître sur les plateformes payantes Paramount+ et MTV, l’émission Frenchie Shore, adaptée des programmes américains Jersey Shore et Geordie Shore, au succès démentiel outre-Atlantique. Vous écrivez : “Pour la première fois, les femmes aussi sont des prédatrices”…
C.V. : Ce qui est positif, c’est que pour la première fois, on a vu une véritable inclusivité, des corps différents, des candidats noirs, une candidate transgenre. Et lorsqu’une candidate fait son coming out par exemple, tout le monde s’en fout, ce n’est même pas un sujet. On a une sexualité débridée, mais consentie, du moins à l’image. Mais après, très vite, les travers patriarcaux rattrapent le programme. La pratique sexuelle centrale par exemple, c’est la fellation. D’autres formes de sexualité moins patriarcales et dominatives ne sont pas montrées. Il y a aussi beaucoup de rivalités féminines. Là où un clan de garçons va vite se créer, les filles vont passer leur temps à se déchirer pour se réconcilier. On a l’impression que malgré les tentatives, cette télé-réalité n’a pas pu échapper au démon du patriarcat.
Pensez-vous qu’il sera possible d’avoir un jour de la télé-réalité éthique et saine ?
C.V. : Je pense que oui. Il y a en tout cas une demande du public en ce sens. Je pense qu’il y a aussi un changement de génération. Moi, je fais partie d’une génération où la sororité n’était pas forcément une valeur cardinale pendant l’adolescence. Là, où aujourd’hui, les jeunes filles ont davantage tendance à se soutenir et moins à se juger. On accepte aussi beaucoup plus les différentes orientations sexuelles. Cette nouvelle génération a finalement besoin de programmes qui lui ressemblent.
Pour vous, la télé-réalité aujourd’hui, c’est fini. Vous n’en consommez plus ou du moins pas pour le plaisir. Auriez-vous des conseils à donner à des jeunes consommateur·rices qui souhaiteraient à leur tour changer leur regard sur ces programmes ?
C.V. : La télé-réalité, on ne doit pas forcément s’interdire d’en regarder, c’est un peu comme TikTok ou les comédies romantiques, il faut être armé pour pouvoir déconstruire ce qu’on regarde. C’est ça, la clé. Et c’est pour cela que je pense qu’il est important de continuer à écrire sur le sujet et de continuer à lire ce que les journalistes et les chercheurs disent de la télé-réalité. On peut tout à fait continuer à regarder des choses qui ne sont pas forcément progressistes, mais il faut être équipé pour cela. Ce qui serait intéressant à faire d’ailleurs, ce sont des interventions dans les écoles pour pouvoir justement en parler avec les ados.
Vivre pour les caméras, ce que la téléréalité a fait de nous, de Constance Vilanova. JC Lattès, 240 pages, 20 euros.