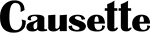On ne présente plus Claude Ponti. Auteur de plus de quatre-vingts livres, le père de Blaise, le poussin masqué (dont les nouvelles aventures ont débarqué en librairies le 27 mars) accompagne les jeunes lecteurs·rices depuis près de quarante ans avec ses œuvres pleines de fantaisie, de jeux de mots et de profondeur. Littérature jeunesse, enfance, #MeToo… À l’occasion de la Journée mondiale du livre pour enfants, Causette lui consacre un grand entretien. Ou, pour le dire façon Ponti, un “grand temps Treutien”.
Causette : Depuis la publication de votre premier album jeunesse, en 1986, vous vous êtes imposé comme un auteur à succès et même, disons-le, comme un monument du genre. Adolescent, pourtant, vous vous rêviez en “peintre maudit”…
Claude Ponti : C’est vrai qu’à l’époque, mes modèles, c’était Van Gogh, Modigliani, etc. Des gens qui avaient eu un peu de mal dans leur vie. Et ça me paraissait évident que ce sont quand même des métiers très difficiles. En plus, comme mes parents étaient archi contre, j’avais la démonstration que c’était difficile tous les jours.
À votre avis, quel regard porterait l’adolescent que vous étiez sur votre réussite dans la littérature jeunesse ?
C. P. : J’ai quand même beaucoup de respect et d’affection pour moi-même. Et je pense qu’il serait content. Par forcément parce qu’il verrait ça comme une réussite, mais parce que par rapport à beaucoup de gens, j’ai l’extrême, extrême plaisir et privilège de faire ce que j’aime et d’aimer ce que je fais. Je sais que j’ai beaucoup de chance.
Depuis bientôt quarante ans que vous publiez des livres pour la jeunesse, vous n’avez jamais eu envie de faire autre chose ?
C. P. : Non. Quand je suis arrivé à Paris, j’ai fait de la peinture, de la gravure. J’étais et je suis probablement encore quelqu’un qui ne sait pas apprendre dans les endroits faits pour ça, donc j’ai appris tout seul. Pour vivre, j’ai fait le coursier dans un journal qui, pour ma chance, était L’Express. Après, ils m’ont demandé de faire des dessins. Donc j’ai eu un métier alimentaire qui est devenu un métier très intéressant, qui était de faire du dessin de presse. À un moment, ma fille est arrivée et j’ai décidé de faire un livre pour elle. Je voulais lui faire un cadeau archi personnel. Finalement, ce livre a été publié [Le livre d’Adèle, 1986], puis d’autres. Un jour, un ami est venu à la maison et s’est étonné que les tableaux que j’avais commencés, presque deux ans avant, soient toujours là. En fait, je m’étais arrêté de peindre sans m’en rendre compte. C’est la preuve, probablement, que ça ne m’a jamais manqué.
C’est vrai aussi que mes rapports avec le monde de l’art étaient assez difficiles. Être exposé en galerie, voir un tableau ou un dessin, très personnel, être acheté par quelqu’un que je trouve absolument “débectable”, c’est extrêmement douloureux. Et l’idée que je vendais trois sous un tableau à quelqu’un qui trente ans après le vendrait des millions – je plaisante, mais c’est un peu ce qu’ils ont dans la tête… À mon premier livre, j’ai eu à rencontrer des enfants qui[…]