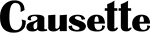Du péché originel à aujourd’hui, les femmes ont appris à dompter leur estomac, mesurer les quantités, compter les calories, préparer pour les autres tout en s’affamant en cuisine. Dans son essai Mangeuses, Lauren Malka, collaboratrice régulière de Causette, tente de comprendre à travers des exemples piochés dans l’histoire, l’art, la religion comment on a déréglé l’appétit des femmes. Interview.
Causette : Dans Mangeuses, vous parlez des femmes comme d’une communauté d’affamées. Qu’entendez-vous par là ?
Lauren Malka : Au départ, l’idée de considérer les femmes du passé et d’aujourd’hui comme un « monde d’affamées » me paraissait un peu osée. C’était comme ça que je voyais le monde, mais je ne me sentais pas autorisée à le dire ainsi. Et puis j’ai interrogé des femmes et des jeunes filles de différents âges et milieux sociaux. J’ai lu Simone de Beauvoir en y cherchant des confidences sur son rapport intime à l’acte de manger, ainsi que George Sand, Colette, Marguerite Duras… ces écrivaines qu’on qualifie habituellement de « gourmandes » pour vérifier si elles l’étaient vraiment. J’ai été sidérée de constater que, tout en se disant « gourmandes » ou en garnissant allègrement les pages des anthologies culinaires, ces femmes que je rencontrais ou que je lisais avaient un rapport tourmenté à l’acte de « manger ». Ensuite, je suis tombée sur cette phrase magnifique de Roland Barthes qui dit tout : « Dans l’immense mythologie que les hommes ont élaborée autour de l’idéal féminin, la nourriture est systématiquement oubliée ; on voit communément la femme en état d’amour ou d’innocence ; on ne la voit jamais manger : c’est un corps glorieux, purifié de tout besoin. Mythologiquement, la nourriture est affaire d’hommes ; la femme n’y prend part qu’à titre de cuisinière ou de servante ; elle est celle qui prépare ou sert, mais ne mange pas. » Voilà comment je me suis autorisée à aller au bout de cette vision du monde féminin comme une histoire d’affamées.

“La peur de grossir dépasse chez les jeunes femmes celle de développer un cancer du sein, de voir se déclencher une guerre nucléaire ou de perdre ses deux parents”
Comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux femmes qui mangent ?
L. M. : À titre personnel, la nourriture a toujours été une source de préoccupation. Cela a empiré quand j’ai commencé à faire des régimes, ce qui est arrivé assez tôt dans ma vie, comme pour beaucoup de femmes. J’avais parfois l’impression d’être la seule à vivre ça, et à la fois le pressentiment que toutes les femmes partageaient cette expérience. Malgré tout, je sentais bien que ce n’était pas qu’une question d’apparence, de minceur, mais aussi de comportement vis-à-vis de la nourriture, de ne pas se laisser aller à ses pulsions. J’ai voulu en avoir le cœur net.
Selon vous, le dérèglement de l’appétit des femmes n’est donc pas, comme on le croit souvent, un phénomène récent essentiellement lié à un souci d’apparence ?
L. M. : Dans le livre, je cite une enquête américaine qui affirme que la peur de grossir dépasse chez les jeunes femmes celle de développer un cancer du sein, de voir se déclencher une guerre nucléaire ou de perdre ses deux parents. Une peur aussi profonde ne peut pas être uniquement un souci d’apparence qui date des magazines de mode. Je pense que c’est plutôt une culpabilité séculaire, liée au fait de se laisser aller à ses pulsions, la transgression ultime pour une femme. Pour comprendre ça, il faut analyser le rapport au péché de gourmandise dans notre société : c’est le premier, donc le moins grave, mais aussi celui qui mène à tous les autres. Il y a Ève, qui croque la pomme et mène l’humanité au désastre. Dans la mythologie, il y a Pandore, une humaine merveilleusement belle, mais qui cache un « gaster », ventre affamé, insatiable. Donc, depuis l’Antiquité, les femmes qui mangent sont représentées comme des monstres, des êtres coupables qui sont incapables de maîtriser leurs pulsions et leurs émotions. Par conséquent, je pense que la minceur, le fait de manger peu est un moyen pour elles de montrer qu’elles ont bien compris ce message qui pèse sur leurs ventres, qu’elles ont réussi à dompter leurs instincts.
“Pendant longtemps, les femmes n’étaient pas autorisées à entrer dans les restaurants, elles attendaient dans la voiture pendant que leur mari allait manger”
Donc une femme qui mange, c’est une femme qui ne reste pas à sa place, une menace pour le patriarcat ?
L. M. : C’est plus pernicieux que cela. Dès le berceau, la petite fille apprend à se montrer gourmande (c’est une part de sa féminité) MAIS frustrée. Elle doit tendre les mains vers le pot de confiture et se faire rabrouer et dompter. C’est ce qu’illustre l’anthropologue Françoise Héritier : dans de nombreuses civilisations, on donne la tétée en premier et plus longtemps aux petits garçons. Dès lors, cela crée deux catégories d’humains : les hommes, à qui l’on dit « tes pulsions sont souveraines » et les femmes, dont les pulsions devront être maîtrisées, frustrées.
Les hommes, eux, ne sont jamais condamnés moralement pour avoir été trop gourmands ?
L. M. : Ce que je cherche à montrer dans mon enquête, c’est que les hommes ont réussi à échapper aux soupçons qui pesaient sur leur gourmandise grâce à la merveilleuse invention de la gastronomie. Au XIXe siècle, Grimod de La Reynière a voulu réhabiliter le péché de gourmandise et en faire quelque chose de noble, relié à l’érudition. Il a détaché la gourmandise du ventre, donc des instincts, pour l’associer au cerveau et faire de l’acte de manger un travail intellectuel… Mais il en a privé officiellement les femmes. Jusqu’à très récemment, elles étaient exclues de ce cercle de la gastronomie érudite, strictement masculin. Le mot « gourmet » n’existe même pas au féminin. D’ailleurs, pendant longtemps, les femmes n’étaient pas autorisées à entrer dans les restaurants, elles attendaient dans la voiture pendant que leur mari allait manger. Les seules tolérées dans ces lieux étaient les courtisanes. Laissées sur le seuil, avec les gloutons, les enfants et les bêtes, les femmes n’ont eu, jusqu’à leurs combats récents, aucune clé pour accéder à une inclination gourmande noble et distinguée et sortir de leur association au ventre et à l’animalité.
“C’est le capitalisme, la société de consommation qui a ensuite transformé cette quête de minceur émancipatrice en injonction, en tyrannie de la maigreur”
Dans le livre, vous suggérez que la minceur, voire l’anorexie, a pu être utilisée par certaines femmes comme un moyen de faire oublier leurs corps, de rejeter leurs pulsions, pour qu’on tienne compte enfin de leur esprit et de leur intelligence…
L. M. : C’est mon hypothèse, même si ce n’était pas conscient ni même le seul déclencheur de leur expérience anorexique. Je mentionne notamment Pélagie d’Antioche, une prostituée au Ve siècle d’une grande beauté. Elle était scandaleuse, jugée impudique, car elle apparaissait en public trop peu vêtue. Un jour, elle a décidé de se repentir et de se punir pour ses péchés. Elle s’est exilée et a cessé de manger. Elle est devenue frère Pélage. D’après une historienne, elle est la première transgenre connue de l’Antiquité. Mon analyse, c’est que la privation de nourriture était le seul moyen pour elle de s’exonérer des soupçons liés à son corps, peut-être aussi celui de rejoindre une forme d’esprit pur, de quitter toutes ses culpabilités. Le plus fou, c’est d’imaginer que l’unique manière pour une femme, à l’époque, d’être considérée comme une citoyenne acceptable, c’était de devenir un homme. Et cela passait par l’anorexie absolue.
La minceur a même fait partie de l’élan féministe dans les années 1920–1930. Ça paraît difficile à croire aujourd’hui…
L. M. : Pourtant c’est le cas. Il s’agissait de se débarrasser des rondeurs, marqueurs de la féminité pour avoir un corps plus athlétique, plus apte à l’activité et au travail. C’est le capitalisme, la société de consommation qui a ensuite transformé cette quête de minceur émancipatrice en injonction, en tyrannie de la maigreur. C’est l’un des exemples de backlashs analysés dans le livre de Susan Faludi qui porte ce titre *.
“Les femmes sont infériorisées dans leur rapport ‘pathologisé’ à la nourriture, car elles sont ramenées à leurs pulsions, à la nature, au sauvage”
Le sujet des troubles des conduites alimentaires (TCA) n’est évoqué que dans le dernier chapitre. N’est-il pas pourtant au cœur du sujet ?
L. M. : Si, c’est même la raison pour laquelle je n’en parle qu’à la fin, tout y mène. Mais ce que je voulais montrer avant de l’aborder, c’est qu’on a fabriqué chez les femmes un rapport à la nourriture complètement déréglé. Et cela ne concerne pas que les personnes qui rentrent dans les critères officiels des TCA définis par la Haute Autorité de santé, cela concerne, à mon sens, toutes les femmes.
Est-ce que, selon vous, ces critères de définition des TCA invisibilisent ce rapport troublé à la nourriture généralisé chez les femmes ?
L. M. : Évidemment qu’il est important de nommer ces pathologies et de les définir sur un plan médical. Mais je pense que ces définitions sont encore empreintes de sexisme, sans aucune connaissance de tout ce spectre immense de la préoccupation des femmes vis-à-vis de la nourriture, qui définit aussi une forme de trouble des conduites alimentaires. Un médecin à qui j’ai demandé comment caractériser les TCA m’a répondu : « C’est l’envahissement du champ psychique par la nourriture. » Ce qui dépasse largement les critères officiels de l’anorexie et de la boulimie. On dit que 20 % des femmes sont dans ce spectre. Je pense que la proportion est bien plus grande.
Vous terminez le livre en évoquant les théories écoféministes. Est-ce une piste pour réconcilier les femmes avec leur appétit ?
L. M. : Ce que je montre, c’est que les femmes sont infériorisées dans leur rapport « pathologisé » à la nourriture, car elles sont ramenées à leurs pulsions, à la nature, au sauvage. Au lieu de s’en défendre, pourquoi ne pas choisir de revendiquer ces stigmates en se disant que, peut-être, on est humaine de cette manière, en étant du côté de la nature ? C’est ce que propose l’écoféminisme. Je ne sais pas si c’est la solution, mais je trouve que c’est très puissant de se dire que ces questions de nourriture ne se posent pas uniquement sous la forme de pathologies que nous devrions affronter seules, de façon culpabilisante et avilissante. Qu’au contraire, nous pourrions les attraper, nous en emparer et en tirer le fil d’un combat politique et collectif.
Mangeuses. Histoire de celles qui dévorent, savourent ou se privent à l’excès, de Lauren Malka. Éditions Les Pérégrines, 290 pages, 20 euros.
* Backlash. La guerre froide contre les femmes, de Susan Faludi. Des femmes-Antoinette Fouque, 1993.