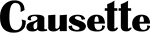Dans une période marquée par l’inflation et les difficultés accrues des Français·es pour se nourrir, la journaliste Nora Bouazzouni s’interroge dans son essai Mangez les riches sur les dérives et les limites de notre système alimentaire. Interview.
Illusion d’abondance, surproduction qui ne profite qu’à certain·es, inégalités de plus en plus creusées et visibles… Dans un essai au titre incisif, Mangez les riches (Nouriturfu), Nora Bouazzouni, journaliste spécialisée sur les questions liées à l’alimentation et au genre, passe la nourriture au crible du prisme social. Dans une période marquée par l’inflation et les difficultés accrues des Français·es pour se nourrir, elle s’interroge sur les dérives et les limites de notre système alimentaire, ainsi que sur les solutions qui pourraient être mises en place. Le temps presse, estime-t-elle auprès de Causette.
Causette : Après avoir analysé nos rapports à la nourriture sous le prisme du genre, vous vous tournez désormais vers le prisme social. Pourquoi ?
Nora Bouazzouni : J’ai eu l’impression d’avoir, entre guillemets, fait le tour de la perspective genrée pour analyser nos habitudes alimentaires, notre rapport à la nourriture et le système alimentaire. Je crois qu’il y a aujourd’hui un rapport avec l’urgence : l’urgence climatique, l’urgence sanitaire, l’urgence sociale. Voir qu’il y a autant de gens qui ne se nourrissent pas suffisamment et correctement dans le monde entier, alors qu’on produit de quoi nourrir le monde entier, m’a motivée pour écrire cet essai. L’idée principale que je défends est qu’il ne s’agit pas d’une question de disponibilité mais d’accessibilité. Bref, j’ai souhaité montrer les coulisses et les rouages de notre système alimentaire et avoir une vision un peu globale, économique et sociale de l’alimentation.
Votre livre s’appelle Mangez les riches. Comment vous est venue cette expression et que signifie-t-elle ?
N. B. : Il s’agit d’une expression que j’avais entendue il y a déjà très longtemps à l’étranger, notamment dans la bouche de différents mouvements politiques, comme Occupy Wall Street, aux États-Unis, ou Podemos, en Espagne. En France, je ne la voyais pas beaucoup. Elle a commencé à fleurir au moment des manifestations contre la réforme des retraites, lorsque j’étais en plein dans l’écriture de mon essai. L’expression est un peu déstabilisante. Des gens m’ont dit qu’ils la trouvaient “violente”. Mais, moi ce que j’entends par “Mangez les riches”, c’est qu’on a des riches qui dévorent le monde, ne nous laissent que les miettes et dévorent même les corps à travers un système politique, économique et discriminatoire. Il s’agit vraiment d’une invitation à renverser la table : mangeons les riches avant qu’ils ne nous mangent !
L’alimentation est un droit, selon une définition des Nations unies, que vous citez dès le début de votre ouvrage. Vous démontrez, sans surprise, que ce droit n’est pas respecté et que les inégalités d’accès à la nourriture se creusent de plus en plus en France entre les différentes classes sociales…
N. B. L’État ne respecte pas ses devoirs vis-à-vis des citoyens et citoyennes, des devoirs fondamentaux qui relèvent de la survie, de la vie, de la bonne santé des gens. C’est une hypocrisie terrible, surtout quand on voit à quel point l’État, les gouvernements successifs se félicitent, parlent de croissance, de pouvoir d’achat. Je déteste cette expression, je préfère parler de “reste à vivre”.
On voit que les inégalités se creusent partout. Selon le dernier baromètre du Secours populaire, diffusé en septembre dernier, un tiers des Français se prive d’un repas, un tiers se prive aussi pour que leurs enfants mangent. La moitié des Français ne peuvent pas consommer de fruits et de légumes tous les jours. On a des parents qui ont du mal à payer à la cantine, ou des familles où le seul repas équilibré de la journée pour les enfants se fait à la cantine. Entre 2 et 5 millions de gens bénéficient de l’aide alimentaire en Hexagone.
Le plus terrible, c’est que la faim en France ne se voit pas. Elle est invisible. On a cette image imprimée dans tous nos cerveaux de la malnutrition avec de petits enfants noirs dans un pays en Afrique. Donc on a du mal à imaginer ce que c’est que d’avoir faim en France : cela touche aussi des gens qui ont un CDI et un toit sur la tête.
“On a atteint la limite de cette paix sociale puisque Les Restos du cœur vont refuser des gens”
Ces dernières semaines, les Restos du cœur ont lancé un cri d’alerte, indiquant qu’ils allaient devoir refuser des bénéficiaires en novembre. De manière générale, vous qualifiez l’aide alimentaire de “cadeau empoisonné”. Pourquoi ?
N. B. : Le premier problème de l’aide alimentaire est qu’elle est mécanique. Elle dépend de la surproduction. Si on arrête de surproduire et de gaspiller, l’aide alimentaire baisse. Donc cela justifie un attentisme politique et encourage une politique de la surproduction et du gaspillage.
Le deuxième problème est que les dons que l’on réalise pour l’aide alimentaire sont défiscalisés. Sur les 476 millions d’euros par an consacrés à l’aide alimentaire en France, les trois quarts sont des réductions d’impôts. Or, depuis la loi Garot, promulguée en 2016, les grandes surfaces et les industriels ne peuvent plus détruire leurs invendus et doivent les donner aux associations. Et ils bénéficient en retour de réduction d’impôts. C’est fou : les entreprises gaspillent, donnent leurs invendus parce qu’elles sont obligées et en retour reçoivent de l’argent.
Le troisième problème est que l’aide alimentaire n’est pas suffisante : on a encore 16 % des Français qui ne mangent pas à leur faim. Et pour la première fois, une structure comme Les Restos du cœur ne pourra pas accueillir tout le monde. Par ailleurs, toutes les personnes qui pourraient en bénéficier ne s’y présentent pas : seulement une sur quatre. Soit parce qu’elles ne se sentent pas légitimes, pensant qu’il y a “plus pauvres qu’elles”, soit parce qu’elles ont honte, soit parce qu’il y a un éloignement géographique. Il faut aussi avoir les ressources demandées, présenter un bulletin de salaire, ce qui exclut les personnes en situation irrégulière.
Enfin, l’aide alimentaire ne permet pas de couvrir tous les besoins en termes de quantité, au niveau des calories apportées, et de qualité. Tout ce qui est frais, comme les fruits et les légumes, est compliqué à stocker pour les bénévoles. Il n’y a aussi pas suffisamment de poissons, de produits intéressants d’un point de vue santé. La sociologue Bénédicte Bonzi, qui a écrit le livre La France qui a faim [Seuil, mars 2023], parle du concept de violence alimentaire. Elle explique que c’est une violence de se nourrir d’un invendu, de ne pas avoir le choix dans ce qu’on mange, de manger des choses avec des dates limites de consommation passées… L’aide alimentaire maintient la paix sociale, en évitant les vols et les émeutes. Mais pour moi, on a atteint la limite de cette paix sociale puisque Les Restos du cœur vont refuser des gens. Le compte à rebours de la bombe est arrivé à terme. Là, ça va péter !
“On va vers une agriculture d’entreprise, d’usine, de société. On n’a aucune résilience alimentaire ni sécurité alimentaire”
Comment faire ? Faut-il changer l’ensemble du système alimentaire ?
N. B. : On devrait, en tant que personne, être humain, citoyen et citoyenne retrouver de l’agentivité. On devrait pouvoir choisir ce qu’on mange et choisir à qui on l’achète. C’est ce que réclament les partisans d’une Sécurité sociale de l’alimentation (SSA). Il s’agit d’un collectif réfléchissant à la mise en place d’une démocratie alimentaire, c’est-à-dire ne pas être dépendant de tous les systèmes mondialisés, avoir une alimentation plus respectueuse de l’environnement, plus respectueuse aussi des personnes qui produisent ce qu’on mange, de celles qui le distribuent, et enfin des consommateurs. Ce projet vise à reprendre la main sur tout ça.
Aujourd’hui, le système est malade. Les gens, qui consomment et produisent, en sont malades. La Terre est malade. Selon un chiffre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), si on augmente les rendements de nourriture de 60 % d’ici à 2050, il y aura toujours au moins 300 millions de gens qui auront faim. Donc on voit bien que la productivité n’a aucun lien avec l’accessibilité. Surtout, en France, on souffre d’une trop grande importation : 70 % des fruits et 30 % des légumes sont importés. On n’alloue pas assez de terres pour le maraîchage, pour les vergers. Les agriculteurs disparaissent. Donc on va vers une agriculture d’entreprise, d’usine, de société. On n’a aucune résilience alimentaire ni sécurité alimentaire.
L’État doit-il intervenir ?
N. B. : Comme pour le changement climatique, cela n’est en effet qu’une question de volonté politique. Il faut arrêter de croire qu’il existe un grand nombre d’obstacles. Oui, c’est difficile d’être un État et de dire que l’on va agir complètement autrement, de changer les choses du jour au lendemain. On sait que c’est impossible. Personne n’est assez stupide pour imaginer que du jour au lendemain, par exemple, on va consacrer davantage de terres au maraîchage, qu’on va bouleverser les subventions accordées aux agriculteurs. Mais si on ne fait rien, de toute façon, ça ne changera jamais. Des chercheurs affirment qu’une autre agriculture, un autre système est possible. Personne ne dit que ça va être rapide à mettre en place, mais si on ne commence à l’amorcer, cela n’arrivera pas.
Mangez les riches. La Lutte des classes par l’assiette, de Nora Bouazzouni. Nouriturfu/Coll. Le poing sur la table, 160 pages, 15 euros. En librairie.