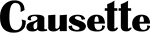Arracher la maternité au silence et la faire entrer dans la littérature : telle est l’ambition de l’écrivaine Julia Kerninon, qui publie ce printemps Être mère. Un recueil collectif éclatant, dans lequel l’autrice de Liv Maria et de Sauvage raconte, aux côtés de six autres autrices, les tempêtes et la puissance de l’expérience maternelle. Interview.
Causette : Il y a deux ans, vous avez publié Toucher la terre ferme, dans lequel vous racontiez votre expérience intime de la maternité. Dans Être mère, paru en avril aux éditions L’Iconoclaste, vous revenez de nouveau sur les tempêtes de la maternité, cette fois accompagnée de six autrices. Pourquoi avoir choisi de réunir plusieurs voix ?
Julia Kerninon : Quand j’ai publié Toucher la terre ferme [L’Iconoclaste, 2019, ndlr], qui était un livre autobiographique, l’un des reproches que des gens ont adressé au livre c’était : “Mais pas du tout, moi ça ne s’est pas du tout passé comme ça.” Il y avait aussi l’accusation de nombrilisme – que je trouve toujours un peu déplacée, parce qu’on se doute bien qu’un livre autobiographique va parler de la vie intime de quelqu’un.
Et puis, quand j’étais enceinte de mon premier enfant, j’ai traduit un ouvrage collectif sur des gens qui ne voulaient pas d’enfants. Le livre collectif, comme la nouvelle, ce n’est pas quelque chose de très courant en France. On a plutôt un mauvais a priori. Pourtant, je me suis dit que, pour parler d’une expérience comme celle-là, ce serait plus intéressant d’unir un chœur de voix pour montrer les variations dans les situations et que tout le monde y trouve son compte.
Ce recueil, écrivez-vous, est une tentative d’“arracher notre maternité au silence” – c’est d’ailleurs le titre le votre texte. Quelles sont ces choses “que les mères n’osent pas dire aux pas-encore-mères”, “qu’elles ne se racontent même pas entre elles” et sur lesquelles ce recueil vient lever le voile ?
J. K. : La réalité de la maternité, j’ai envie de dire. Il existe des manuels sur la maternité, des méthodes pour éviter de faire un baby clash. Il y a aussi quelques livres qui parlent de maternité en racontant des histoires terrifiantes. Mais la maternité n’est pas extraordinairement représentée en fiction, surtout lorsqu’elle concerne la toute petite enfance. Et quand c’est le cas, c’est souvent très modélisé : on va dire “j’aime tellement mes enfants”, ou des choses pas très complexes. Là, l’idée, c’était d’essayer de raconter la vraie vie avec les bébés. Parce qu’en fait, à ce moment-là, ce qui nous occupe la tête, ce n’est pas “comment est-ce que je vais m’habiller pour être quand même mignonne ?”. Ce n’est pas “oh mon Dieu, je l’aime tellement”. S’occuper d’un bébé, c’est un mélange d’efforts, de fatigue, de vertige, de craintes et puis beaucoup d’utilisation du corps. C’est être complètement métamorphosée et peiner à trouver sa place dans cette nouvelle identité. Quand j’ai fait Toucher la terre ferme, c’était un peu la même idée : j’avais envie deraconter ma maternité en la situant à un juste point d’équilibre entre la difficulté et le rêve. Je trouvais que des fois, on était trop d’un côté ou trop de l’autre. Pour moi, c’est une expérience qui est beaucoup plus chamarrée.
Avec ce recueil, vous portez l’ambition de “faire entrer la maternité dans la littérature”. Comment expliquez-vous que l’expérience intime de la maternité, pourtant universelle, ait si longtemps été un sujet littéraire marginal ? A‑t-elle été invisibilisée, au même titre que les autres expériences proprement féminines, ou fait-elle l’objet d’une déconsidération particulière ?
J. K. : Évidemment, la maternité est l’expérience la plus féminine, la plus spectaculaire certainement – dans le sens où c’est extraordinaire. Mais de ce point de vue là, je ne pense pas qu’elle se sépare des autres expériences féminines. Ma théorie, qui est très simple, c’est que la littérature, telle qu’on la connaît, a été écrite principalement par les hommes. Donc il n’y est pas beaucoup question de ce que ça fait d’être enceinte, d’accoucher, d’allaiter, de s’occuper des petits enfants… Parce que c’est un sujet qui concerne, dans la réalité, principalement les femmes et qu’elles-mêmes ne le représentent pas en littérature. Comme la littérature est sourdement masculine, il y a des sujets qui ne nous apparaissent pas comme littéraires. C’est aussi un des buts de ce livre, de commencer à fabriquer des modèles littéraires qui proposent des manières de raconter ça. Plus on va le faire, plus ces sujets vont apparaître comme dignes d’être représentés en littérature. Et petit à petit, ça va fermenter, champignonner un peu partout et on va devenir capable, collectivement, de représenter la maternité en littérature comme elle est réellement.
Vous-même, avez-vous pu avoir des réticences, voire un sentiment d’illégitimité littéraire, à l’idée de traiter la maternité, avec tout ce qu’elle peut avoir de charnel et de trivial ?
J. K. : Je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que, quand j’ai commencé, plus jeune, à réfléchir plus sérieusement à la vocation littéraire, le fait d’être une fille, de province, me semblait être un handicap assez indiscutable. C’était difficile de trouver des sujets qui m’intéressaient et qui pouvaient faire littérature, parce que j’essayais de coller au modèle, qui était masculin. Donc je ne m’y retrouvais pas trop. C’est quelque chose que j’ai dépassé avec les années. Et quand j’ai eu les enfants, ils m’ont donné un regain de confiance en moi. Pourtant, Dieu sait que mes maternités ont été extrêmement neutres et banales. Mais je me suis dit qu’il fallait que ça soit raconté. Je me suis lancée là-dedans, en ignorant à quel point j’allais m’exposer, par exemple. Mais je ne voyais pas comment faire autrement que m’engager dedans.
Récemment, on a vu de plus en plus d’autrices s’emparer de la maternité en littérature. Pourquoi maintenant, selon vous ?
J. K. : Je pense qu’il y a un truc générationnel. Toutes ces femmes ont entre 25 et 40 ans. Nous sommes peut-être la première génération qui arrive avec assez de confiance en nous et davantage d’outils pour le faire. On arrive aussi dans un environnement qui, tout en restant très adverse, est plus adapté à ça. Le gros bouleversement qu’on a eu avec #MeToo a ouvert la porte à plein d’autres sujets. En parlant de la souffrance des femmes, c’est devenu possible, petit à petit, de parler de celle des enfants. La maternité est entrée à la suite de tout ça, avec des podcasts comme Bliss, avec toutes sortes de témoignages. Les femmes ont commencé à se sentir prêtes et en droit de raconter ce que leur expérience avait de singulier.
Vous disiez récemment que c’est lorsque vous avez eu un enfant que vous aviez “compris que [vous étiez] une femme, une fille”. Qu’est-ce qui vous a rattrapée à ce moment-là ?
J. K. : Ce que je raconte, c’est que mon compagnon et moi, on a exactement le même âge, on a le même genre de diplôme, de background. C’est seulement quand on a eu un enfant que mon corps de fille est revenu dans l’affaire. Comme si la structure patriarcale était tout d’un coup entrée dans notre foyer. J’étais responsable de trouver une garde pour l’enfant, de l’allaiter, tous les papiers étaient à mon nom. De façon très sourde, on attendait davantage de choses de moi. À l’inverse, mon compagnon, même s’il faisait beaucoup de choses, était encouragé par la société à en faire moins. À rentrer plus tard du travail, à ne pas se soucier des questions d’anticipation. C’est comme si on devait lutter contre ce truc-là malgré nous. Et ce que je trouve fascinant, c’est que même un compagnon moderne, bienveillant et désireux de bien faire, a lui aussi comme un petit diable sur son épaule qui lui dit qu’il est là en renfort mais que c’est pas son truc. On se retrouve à avoir des disputes de couple qui ne sont pas des disputes entre deux individus, mais des disputes inhérentes à la structure déséquilibrée dans laquelle on vit.
Comment avez-vous vécu cette prise de conscience, où l’on se découvre femme à ses dépens ? Est-ce que ça a été un catalyseur féministe ?
J. K. : Oui, certainement. Les machos vont dire des choses comme : “Je sais pas pourquoi vous faites autant d’histoires avec la maternité, les femmes accouchent depuis la nuit des temps.” C’est vrai. Mais en même temps, à chaque fois qu’une femme accouche pour la première fois, pour elle, c’est la première fois. Nous dire“vous avez toujours fait ça, vous êtes des mammifères, qu’est-ce que vous voulez, qu’on le fasse à votre place ?”, c’est une des méthodes employées par la société pour nous empêcher de raconter ce qui s’est passé. Comme si la douleur d’un accouchement devait être tue, simplement parce qu’elle a été précédée par d’autres douleurs qui, pourtant, ont elles aussi été tues.
Avoir des enfants m’a donné une sensation de puissance, indiscutablement. L’idée de ce que mon corps avait fait, puis réussir à les élever, les éduquer, en prendre soin, ça fait partie des choses les plus incroyables que j’ai faites. Donc, il y a eu une sensation de déploiement total. Et aussi beaucoup, beaucoup de colère. Une colère que je n’avais jamais ressentie. De voir comment on essayait de me limiter, de voir les injonctions qui pesaient sur moi. Et puis cette espèce de croyance de la société qu’en devenant maman, on ne va plus rien être d’autre. Toutes ces phrases qui disent : “De toute façon, quand on a un enfant, on ne pense plus à rien d’autre.” Bien sûr que je vois ce que ça veut dire. Bien sûr qu’avoir un enfant, ça veut dire être toujours un peu inquiète pour quelqu’un d’autre, être terrifiée à l’idée qu’il puisse lui arriver quelque chose. Mais dans mon cas, cette peur n’a pas pris la place de toute mon identité. Et je pense que ça ne doit pas prendre toute la place. Ça ne rend pas l’amour plus efficace que d’être terrorisée à l’idée de perdre l’objet de cet amour.
La question de la liberté traverse votre travail. Comment la maternité est-elle venue redéfinir votre propre liberté ? S’est-elle révélée libératrice à certains égards ?
J. K. : Parfois, j’entends des femmes dire à quel point elles étaient peu préparées à ce que signifiait l’arrivée d’un enfant. Comment elles sont surprises de la longueur du post-partum, comment elles n’avaient pas vraiment anticipé à quel point un enfant ça veut dire “tout le temps”. En ce qui me concerne, c’était des trucs que mes parents évoquaient beaucoup. Ils étaient très engagés avec nous, mais ne faisaient pas mystère de ce qu’ils avaient sacrifié pour être parents. Donc je savais, avant d’avoir les enfants, à quel point j’étais libre. Je me doutais que ça allait être très différent, mais j’étais prête. Et ça m’a paru beaucoup moins pire que ce que j’avais imaginé. Après, je pense aussi que je me suis habituée. Les premiers mois, c’est très étrange de se dire : “Je ne peux pas sortir de la maison. Ou alors, il faut que je prenne le bébé avec moi.” L’espace semble se réduire un peu. Mais ensuite, les enfants grandissent et, petit à petit, on récupère cette liberté. Elle prend d’autres formes, aussi. Et puis les enfants ont beaucoup structuré mon emploi du temps. Et en me structurant, ça m’a dégagé de la liberté. Je me suis mise à travailler de façon beaucoup plus efficace. Avoir des enfants a été psychiquement libérateur.
Vous écrivez : “Les gens me demandent souvent si les enfants ont entravé mon écriture – mais personne ne devine que parfois l’amour des livres m’empêche d’être une mère.” C’est vrai qu’on interroge souvent les conséquences de la maternité sur l’écriture, mais rarement l’inverse. Selon vous, qu’est-ce que la littérature peut avoir comme effet sur votre façon de vivre votre maternité ?
J. K. : Je me demande toujours quels livres j’écrirais si je n’avais pas eu les enfants. Je ne saurai jamais s’ils auraient été meilleurs. Parfois, j’entends des collègues autrices dire : “Je ne veux pas d’enfants parce que je ne pourrai pas écrire si j’en ai” ou alors “Je ne veux pas d’enfants tant que je n’ai pas fait un premier livre”. C’est récurrent de mettre les deux en compétition. Mais croire qu’on ne peut pas faire les deux à la fois, je me dis parfois que c’est une croyance d’hommes. Les femmes, partout, dans tous les corps de métier, ont des enfants et travaillent.
L’écriture n’est pas un truc aussi dark que ce qu’on voudrait raconter. Dans mon cas, ce n’est pas quelque chose où je suis plongée si profondément dans ma création que je ne suis pas là pour mes enfants. Il y a la légère impatience, les soirs où j’écris et que mes enfants m’interrompent – ce que je raconte dans le livre. Mais si je n’écrivais pas, est-ce que je serais extrêmement disponible, est-ce que j’irais dans leur lit pendant des heures ? Non, je suppose que j’aurais un autre loisir du soir. Après, mon métier fait que je pars en tournée, donc je suis quand même séparée de mes enfants une partie du temps. Mais je me dis que c’est trois mois tous les deux ans. Mes parents bossaient dans un pensionnat : chaque semaine, il y avait une nuit sans mon père et une nuit sans ma mère. Je trouvais ça agréable aussi. Forcément que mes enfants sont impactés par mon travail, comme le sont tous les enfants par tous les métiers de leurs parents. Finalement, ce vieux truc de “soit les enfants, soit les livres” c’est, pour moi, une vision un peu réductrice.
Vous évoquez l’entrée dans la maternité comme une traversée et la parentalité comme un seuil “qu’on ne peut franchir qu’une fois”. Comment êtes-vous ressortie de ce passage d’une rive à l’autre ?
J. K. : Avec la sensation d’avoir survécu. C’était ça, l’idée de Toucher la terre ferme. On sait que les premières années sont éprouvantes. Maintenant, on conseille même aux jeunes parents de ne pas se séparer dans les premiers temps : ça montre bien que c’est de l’ordre de quelque chose à traverser. La première année a été assez rock’n’roll. Mais j’étais assez confiante, ça n’a jamais été horrible. Je voyais que j’étais dans une traversée tempétueuse. Et je suis contente d’être arrivée à un endroit plus stable, même si je sais qu’il y a aussi d’autres défis, très exigeants, qui vont se présenter.
Quant au seuil, c’est comme ça que je me représentais les choses avant d’avoir les enfants : d’un côté, je voulais en avoir et, de l’autre, je savais que si j’en avais, je ne pourrais pas faire demi-tour. Je savais que, pour satisfaire à ma curiosité, j’allais passer pour toujours de l’autre côté de ce seuil. Donc j’espérais très fort que je n’allais pas être déçue, que j’allais être à la hauteur, que j’allais réussir à tenir ce truc-là.
Dans son dernier livre Messieurs, encore un effort…, Elisabeth Badinter estime que les mouvements féministes ont libéré les femmes, mais pas les mères. Partagez-vous ce constat ?
J. K. : Je ne suis pas spécialiste, même si je me renseigne pas mal. Mais c’est vrai que c’est un truc que je me suis formulé, cette nécessité d’inventer un “féminisme de la mère de famille”. Une fois, j’ai écouté une interview passionnante de Victoire Tuaillon. Elle recevait le sociologue Jean-Claude Kaufmann sur la répartition des tâches, vaste sujet. Lui expliquait qu’au rythme auquel on se trouve, cette égalité ne pourrait pas être atteinte collectivement avant cent ou deux cents ans. Ce qui a beaucoup énervé Victoire Tuaillon, qui disait : “Je refuse de faire vie commune avec un homme tant que cette égalité n’est pas possible.” Évidemment, quand j’écoute ça, je trouve ça brillant, courageux, révolutionnaire. Sauf que ce n’est pas une méthode qui peut m’être utile à moi, parce que j’ai deux enfants avec un homme. Alors je sais qu’on peut faire famille autrement, qu’on peut être très amoureux et ne pas vivre ensemble. Mais on sait tous que ça nécessite de l’argent, que c’est quand même moins pratique que d’être tous dans la même maison. Et puis j’ai envie d’habiter avec mon compagnon et que mes enfants vivent avec leurs deux parents le plus souvent possible.
Du coup, cette façon de mener la lutte ne peut pas fonctionner pour nous, les mères de famille. On a besoin d’autres solutions, d’autres ruses. Surtout, on a besoin qu’on ne nous envoie pas bouler avec des phrases du genre : “Tu l’as choisi”, “T’as qu’à faire grève”. C’est plus compliqué. Et c’est une autre chose dont on ne peut pas exiger qu’elle soit tue. En fait, être une mère de famille, c’est avoir une féminité – avec tout ce qu’elle a d’handicapant – qui pèse un peu plus lourd. On a besoin de pouvoir discuter, décortiquer les différentes solutions à notre portée.
Nous publions cet entretien le jour de la fête des Mères. Que leur souhaitez-vous, à ces mères ?
J. K. : La reconnaissance. Être une mère de famille, c’est pas sexy – je veux dire, en dehors de la question de la joliesse. Une mère de famille, c’est pas une héroïne. C’est partie négligeable. Alors qu’avec leur corps, elles ont permis que la lignée humaine continue. Les hommes n’ont pas envie d’écouter nos histoires de périnée distendus, de nous voir allaiter en public. Mais quelqu’un l’a fait pour eux, sinon, ils ne seraient pas là. Les mères tiennent les familles, tiennent les maisons, l’harmonie, la tendresse, elles tiennent toutes ces choses-là. Elles le font tout en continuant à travailler, tout en s’inquiétant des choses. C’est un putain de boulot d’être une mère de famille ! Je rêve d’un jour où, au lieu d’avoir une sorte de mépris moqueur pour ces femmes qui ne sont plus des jeunes filles, qui sont souvent un peu débraillées, on ait beaucoup d’admiration et de reconnaissance pour elles. Du respect, plutôt. On a autre chose à faire de nos vies qu’être remerciées – même si c’est encore pire quand on ne l’est pas – pour des tâches qu’on fait à la place des autres. Donc du respect pour les mères de famille, ce serait pas mal.
LIRE AUSSI I “Bonne Mère” : notre entretien prénatal avec Laura Domenge

Être mère, ouvrage collectif. L’Iconoclaste, 155 pages, 18 euros.