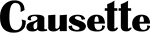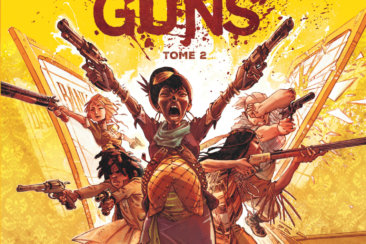Hamnet, de Maggie O’Farrell, Comme des bêtes, de Violaine Bérot, La Rivière des disparues, de Liz Moore, Les femmes qui craignaient les hommes, de Jessica Moor, Sous le signe des poissons, de Mélissa Broder et Tous les noms qu’ils donnaient à Dieu, d’Anjali Sachdeva.
Hamnet, l’autre Shakespeare
Les historiens n’ont jamais complètement tranché quant aux liens entre le Hamlet de Shakespeare et le prénom de son seul fils, Hamnet. Pour son neuvième roman, la britannique Maggie O’Farrell (dont on apprécia I am, I am, I am il y a deux ans) redonne de l’air à ce fils oublié, nous faisant entrer dans l’intimité de la famille de façon audacieuse : « Wil » est relégué au second plan. Le roman s’étire le long de cette journée de 1596 où la mort emportera le garçon de 11 ans (peste bubonique), et alterne avec le récit de la rencontre entre le dramaturge et sa future femme, Agnes, orpheline devenue guérisseuse, ou encore avec des séquences sur l’amour fou de cette mère pour ses trois enfants (dont les jumeaux Judith et Hamnet). Par de multiples petites portes et par une narration vibrante, le roman pénètre les coulisses de l’œuvre shakespearienne avec une remarquable délicatesse. H.A.

Hamnet, de Maggie O’Farrell, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Sarah Tardy. Éd. Belfond,
368 pages, 22,50 euros.
Comme des bêtes, frayeurs pyrénéennes
C’est un conte de fées… qui a tout d’une terrifiante histoire vraie. Dans Comme des bêtes, la romancière Violaine Bérot, ancienne éleveuse de chèvres, nous fait entendre son chant de colère contre les institutions qui écrasent les êtres. L’histoire se déroule dans un village des Pyrénées, un lieu empreint de croyances. Le personnage principal, surnommé l’« Ours », parce qu’il grogne et ne communique qu’avec les bêtes, est mis en cage. Il aurait attaqué un randonneur après avoir été surpris en train de jouer avec un âne et une fillette. Qui est cette fille qu’aucun·e habitant·e ne connaît ? Pourquoi l’« Ours » vit-il à l’écart du village, seul avec sa mère ? Pourquoi celle-ci l’a-t-elle retiré de l’école, il y a vingt ans ? Échos, rumeurs… l’interrogatoire de police commence. Les voix de témoins – ancien·nes camarades de classe, instituteur·rices, mais aussi celles des fées qui peuplent le village – se succèdent, nous encerclent jusqu’à former un cantique rural dont nous sommes captif·ves. Face à tant de beauté et d’effroi, nous n’avons qu’à nous laisser traverser de part en part. Un frisson. L.M.
Comme des bêtes, de Violaine Bérot. Éd. Buchet-Chastel, 160 pages, 14 euros.
La Rivière des disparues, soeurs contraires
Bien des choses marchent par deux dans les sales affaires de Philadelphie dont il est question ici. Le quatrième roman de Liz Moore (le deuxième traduit en France) est l’histoire de deux sœurs : l’aînée, Michaela Fitzpatrick, agente de police qui patrouille dans le quartier de Kensington, et Kacey, la cadette, devenue toxico et prostituée à l’occasion. La Rivière des disparues est un récit à deux faces. La première est un polar : les meurtres se multiplient dans les maisons abandonnées, cependant que le trafic d’opioïdes s’intensifie. La policière a donc peur pour sa sœur, qu’elle a perdue de vue. D’autant que Kacey semble avoir disparu. La seconde face, constituée de flashback, montre les deux femmes des années avant, lorsqu’elles étaient fusionnelles. Le tout est une fiction dense et pleine d’empathie, qui repose sur un travail de terrain effectué par l’autrice il y a dix ans. H.A.
La Rivière des disparues,
de Liz Moore, traduit de l’anglais (États-Unis) par Alice Seelow. Éd. Buchet-Chastel, 416 pages, 22 euros.
Les femmes qui craignaient les hommes, mécanique de la domination
C’est souvent comme ça dans le polar : un flic à l’approche de la retraite tombe sur le cadavre qui va changer sa vie d’après. Comme le lieutenant Whitworth, à Widringham, banlieue de Manchester, lorsque celui de Katie est remonté par la rivière. Elle était conseillère dans un refuge pour femmes harcelées ou violentées, et pourtant, ces femmes fuient les questions et l’enquête qui s’ouvrent. Taisent leurs peurs. Comme si les prédateurs rôdaient encore. Ils sont si présents que l’intrigue se déploie de Manchester jusqu’à Londres. Elle repose sur deux ou trois imbroglios qui vous chambouleront l’esprit. Sur des portraits (les femmes du « refuge ») qui vous retourneront le cœur. Jessica Moor a elle-même travaillé auprès de femmes victimes de violences, et on saisit mieux pourquoi ce premier roman démonte les mécanismes de la domination comme d’autres démontent des flingues. H.A.
Les femmes qui craignaient les hommes, de Jessica Moor, traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Alexandre Prouvèze. Éd. Belfond, 352 pages, 21 euros.
Sous le signe des poissons, les maux doux
Quelque part entre Roméo et Juliette, Georges Bataille, Pedro Almodovar et la punkitude lettrée de Patti Smith se nichent les esprits quadragénaires de Lucy, la narratrice de Sous le signe des poissons, et de Melissa Broder, son autrice (découverte dans le recueil de textes autobiographiques So Sad Today, éd. de L’Olivier, 2019). Lucy, donc, rame depuis des années sur une thèse consacrée à Sappho et vient de se faire larguer. Elle passe l’été à Los Angeles chez une sœur dont elle garde la maison (à Venice Beach) et le chien diabétique. Elle s’inscrit à une thérapie de groupe, sans que ça ne règle rien. Elle se met sur Tinder pour des dates qui, au moins, assouvissent ses obsessions sexuelles. Une nuit, plus ou moins torchée, assise sur un rocher devant la mer, elle rencontre un nageur. Suivront d’autres moments de baisers, de sexe et d’orgasmes. Cet homme caresse et lèche comme personne, et pour cause : cet homme qui vit dans l’océan n’est pas qu’un homme. Vous découvrirez de quoi il est fait en même temps que Lucy. Tout ce qu’elle vit existe-t-il ? C’est plus que ça… C’est léger, tranchant, piquant et subversif, aussi intellectuel que sensuel, crasseux qu’élégant. H.A.
Sous le signe des poissons, de Melissa Broder, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle. Éd. Christian Bourgois, 448 pages, 23 euros.
Tous les noms qu’ils donnaient à Dieu, bonnes nouvelles
Vous entrez dans ce recueil par une nouvelle dans laquelle une femme trouve refuge dans une grotte, apeurée par le silence des Grandes Plaines où est située sa maison qu’elle partage avec son mari parti travailler très loin, trop loin, au temps de la conquête de l’Ouest. Une autre raconte une jeune fille ballotée entre un père aux poumons condamnés depuis l’explosion du four de l’usine où il travaille et un homme qui lui propose une exploration en Égypte. Nous sommes fin XIXe, époque où un tel voyage peut encore être un adieu. Vous lirez aussi comment deux Nigérianes, prises en otage par Boko Haram, apprennent à hypnotiser les hommes. Tour à tour cruelles, lyriques, voire quasi chamaniques, voici neuf nouvelles éloignées dans le temps et dans l’espace, qui s’accordent en une même voix, très singulière, celle de l’américaine Anjali Sachdeva. Une révélation. H.A.
Tous les noms qu’ils donnaient à Dieu, d’Anjali Sachdeva, traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Fournier. Éd. Albin Michel, 288 pages, 21,90 euros.