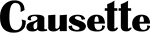Venus à l’hôpital pour leur bébé, ils repartent sans lui. Accusés à tort de maltraitance, des parents se voient retirer leur enfant, atteint d’une maladie rare. Et dénoncent l’emballement d’un système qui, pour mieux protéger, finit par broyer des familles.
Comme bien d’autres parents dans leur cas, c’est avec une précision quasi chirurgicale que Roxane et Olivier racontent ce moment où « le ciel [leur] est tombé sur la tête ». Pour ce couple francilien, tout commence en avril 2021, lorsqu’ils emmènent leur fils Camu, âgé de 20 mois, aux urgences d’un hôpital parisien. Depuis plusieurs semaines, l’enfant, né grand prématuré, multiplie les crises de pleurs sans que ses parents ne parviennent à le soulager. Après avoir consulté plusieurs médecins, ils se rendent donc à l’hôpital une première fois, puis une seconde. « J’ai dû m’énerver pour que son cas soit pris au sérieux », se rappelle Roxane. Fin avril, un diagnostic est finalement posé : Camu souffrirait d’une infection osseuse et doit rester hospitalisé le temps du traitement.
Rouleau compresseur
Mais voilà que quelques jours plus tard, une boule apparaît sur son sternum. De nouveaux examens révèlent alors une fracture et des lésions aux vertèbres. « Le pédiatre nous dit que les fractures au sternum sont liées à des accidents de la route, des chocs. Mais ça ne peut pas être traumatique, puisque Camu était à l’hôpital lorsque la fracture est apparue. Nous ne comprenons pas, et eux non plus », rapporte le couple. Test génétique, scanner, IRM… C’est reparti pour une nouvelle batterie de tests. Jusqu’au 1er juin, où tout bascule. Ce jour-là, Roxane et Olivier sont informés qu’un signalement pour maltraitance va être fait auprès du procureur de la République. « À ce moment-là, je ne veux pas y croire. C’est tellement improbable… », confesse Roxane.
Dès lors, tout s’enchaîne : l’expertise médicale, l’audition par la Brigade des mineurs et le placement provisoire de Camu, le 14 juin. D’abord à l’hôpital, puis en pouponnière, où ses parents ont le droit à une heure de « visite médiatisée » (en présence d’un travailleur social) par semaine. Un mois plus tard, malgré un rapport positif de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), le couperet tombe : la juge des enfants reconduit le placement pour six mois, jusqu’en janvier 2022. Sauf que, entre-temps, de nouveaux éléments viennent rebattre les cartes : non seulement Camu a développé de nouvelles fractures à la pouponnière, mais les résultats du test génétique sont arrivés. Et révèlent que ce bébé souffre non pas de maltraitance, mais d’une ostéogenèse imparfaite, une maladie rare (communément appelée « maladie des os de verre »).
Le 3 août, après sept semaines de placement, Camu peut enfin rentrer chez lui et bénéficier d’un suivi médical adapté. « À partir du moment où le diagnostic est tombé, les professionnels à qui on avait affaire se sont ouverts à nous. Et ça a été encore pire pour moi de réaliser qu’en fait, personne n’avait vraiment cru à notre culpabilité. Mais le rouleau compresseur s’était mis en marche », estime Roxane, qui parle de ce placement injustifié comme d’un « traumatisme ». Traumatisme que cette famille est loin d’être la seule à avoir vécu.
Syndrome du bébé secoué ?
En février 2021, l’association Solhand (Solidarité Handicap) créait la Commission maladies rares et justice pour aider les familles prises dans cet engrenage. Déjà une dizaine en quelques mois. « Ce n’est pas à nous de poser un diagnostic. Mais cela fait vingt ans que nous alertons sur le sujet : toutes les familles dont un enfant est atteint d’une maladie rare sont aujourd’hui susceptibles de voir leur enfant placé », prévient Annie Moissin, présidente de Solhand. Quatre ans plus tôt, une centaine de parents avaient publié une tribune dans Le Monde pour alerter sur leur situation : réunis au sein de l’association Adikia, tous disent avoir été accusés à tort de maltraitance sur leur enfant. À chaque fois, c’est le même scénario. « Alors que nous consultons les urgences pédiatriques pour nos bébés qui font un malaise, les médecins décèlent des signes a priori évocateurs de maltraitance. Il s’agit essentiellement de fractures, d’ecchymoses ou de saignements à l’intérieur du crâne et des yeux (hématomes sous-duraux et hémorragies rétiniennes). [Il se trouve que] ces deux derniers signes sont typiques du “syndrome du bébé secoué”. Dans nos cas, cependant, nos enfants sont atteints de diverses maladies rares », clament-ils.

Parmi eux, il y a Virginie, dont le nourrisson a été placé un mois avant qu’on ne lui découvre une hypofibrinogénémie (un trouble de la coagulation qui peut provoquer des hématomes sous-duraux et des hémorragies rétiniennes). Vanessa, dont le bébé a été placé plusieurs mois, alors qu’il souffrait en réalité d’une hydrocéphalie externe (une pathologie générant, elle aussi, des hématomes sous-duraux et des hémorragies rétiniennes). Ou encore Cyrille Rossant, aujourd’hui président d’Adikia, et lui aussi victime d’une erreur de diagnostic. En 2016, son fils David, alors âgé de quelques mois, est sujet à plusieurs crises de vomissements. « Un virus », selon le pédiatre. Mais la mère de Cyrille, médecin à la retraite, s’inquiète de l’augmentation anormale du périmètre crânien de son petit-fils. Devant son insistance, David est donc reçu à l’hôpital pour des examens, qui révèlent des hématomes sous-duraux et une hémorragie rétinienne. « On nous dit que c’est, à 100 %, un bébé secoué. On était sous le choc. Je savais que ni moi ni ma femme n’avions secoué notre enfant. Ne restait que la nounou : ça ne collait pas, mais on ne voyait pas d’autre explication », relate Cyrille. Le neuropédiatre de l’hôpital, lui, évoque pourtant une autre piste : celle de l’hydrocéphalie externe, une pathologie qui touche 0,6 ‰ des enfants et dont les symptômes sont semblables à ceux du « syndrome du bébé secoué »(SBS). Une contradiction médicale qui sème le doute chez les parents, mais n’empêche pas leur signalement, par l’hôpital, pour suspicion de maltraitance.
Dès lors, la spirale se met en marche, jusqu’au placement de David. « On était dévastés. On a vraiment eu l’impression d’une décision arbitraire, sans même avoir été écoutés ni interrogés par la juge des enfants », poursuit Cyrille. Finalement, lors d’une audience en appel, la justice reviendra sur cette décision : estimant qu’il n’y a pas de risque de danger avéré dans l’environnement familial de David, elle décide de lever le placement. Mais pour Cyrille, le doute persiste : son fils a‑t-il été secoué, comme l’affirme la première expertise ? Quid de l’autre diagnostic évoqué par le neuropédiatre de l’hôpital ? Pour comprendre de quoi il retourne, ce chercheur en neuroscience se met alors à éplucher la littérature scientifique. « Assez rapidement, j’ai vu qu’il y avait une controverse internationale sur le SBS. Et qu’il y avait un gros problème de fond dans la manière de diagnostiquer de manière certaine les secouements, alors même qu’il peut y avoir d’autres explications », pointe-t-il.
Lire aussi l Enfants : maltraitance et autisme, la grande confusion

Une question technique – et hautement sensible –, mais pourtant fondamentale. Depuis 2015, 550 familles ont contacté l’association Adikia pour ce qu’elles estiment être une erreur de diagnostic : dans 85 % des cas, il s’agit du syndrome du bébé secoué. Des cas qui se retrouvent aussi en nombre dans le cabinet de l’avocat Grégoire Étrillard : sur les 125 dossiers d’accusation de maltraitance qu’il défend actuellement, tous sont liés à un diagnostic médical contesté. Et parmi eux, 112 font état d’un SBS. Or, derrière le diagnostic de ce syndrome se pose la question des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS). Car ce sont elles qui sont utilisées, par le corps médical et par l’appareil judiciaire, pour déterminer s’il y a eu maltraitance. Le problème, c’est que ces critères diagnostiques sont sujets à débat. Jugés insuffisants par certains médecins, ils ont aussi été remis en question, en 2016, par la Haute Autorité de santé suédoise.
« Les recommandations actuelles de la HAS sont excessives et ne correspondent pas à l’état de la science. Je ne nie absolument pas l’existence de cas de maltraitances ni la nécessité de les combattre. Mais en l’état, ces recommandations ouvrent la voie à des poursuites injustifiées et à des placements abusifs d’enfants », dénonce maître Grégoire Étrillard. Après avoir saisi (en vain) le Conseil d’État, il envisage aujourd’hui de se tourner vers la Cour européenne des droits de l’homme dans l’espoir de faire abroger ces fameuses recommandations. Car, pour l’heure, la HAS campe sur ses positions, allant jusqu’à qualifier de « négationnistes » ceux qui contestent ses préconisations. Fin 2019, la HAS rappelait d’ailleurs aux professionnels de santé leur devoir de signalement, « même s’ils ne sont pas certains de la maltraitance et sans avoir à en apporter la preuve ». Et c’est peut-être là le problème.
Présomption de culpabilité
Car au-delà de cette bataille d’experts, c’est toute la procédure menant à ces placements qui pose aujourd’hui question. À commencer par le signalement. Depuis 2015, la loi précise qu’un professionnel de santé ne peut être poursuivi pour avoir signalé à tort une situation, sauf à prouver qu’il n’aurait pas agi « de bonne foi ». L’idée étant qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Et qu’un parent, s’il est innocent, pourra toujours prouver sa bonne foi. « Au début, j’ai pris le signalement un peu à la légère », se souvient Maya *, qui sait n’avoir rien à se reprocher. Au printemps 2021, elle et son mari emmènent leur fils de 3 semaines aux urgences, alarmés par les hématomes qui sont apparus sur son visage. Lorsqu’on leur apprend, quelques jours plus tard, que leur bébé présente plusieurs fractures, c’est le choc. « Il était avec nous depuis sa naissance, et il n’était jamais tombé. J’étais sûre qu’il y avait une cause médicale. J’ai parlé de mon accouchement traumatique, ramené mon dossier médical, proposé de passer des examens… Personne ne nous a écoutés », dit amèrement la jeune mère, dont le fils sera finalement placé trois mois. Une fois la machine judiciaire en route, les recherches médicales s’arrêtent – l’expertise médicale réalisée après le signalement faisant office de diagnostic. Comment, dès lors, prouver son innocence ? « C’est très compliqué. Déjà, il faut pouvoir avoir accès au dossier médical de son enfant. Dans l’enquête que nous avons réalisée en 2020 auprès de 150 familles, seules 44 % ont pu l’obtenir. Et 39 % disaient qu’il manquait des pages importantes. Ensuite, il faut trouver des médecins qui acceptent de se pencher sur ces cas et qui soient compétents pour traiter ces dossiers souvent complexes. Mais même si certains acceptent, ces expertises n’ont aucune valeur juridique. Quand on est parents, on n’a donc quasiment aucun moyen de prouver son innocence. C’est tout le problème », résume Cyrille Rossant, d’Adikia.
À cette « présomption de culpabilité » s’ajoute une certaine opacité de l’ASE, chargée de réaliser les enquêtes sociales sur lesquelles s’appuient ensuite les juges des enfants. Des rapports auxquels les parents n’ont généralement pas accès et que leurs avocats – s’ils en ont un – découvrent la veille, voire le jour de l’audience. Ce que dénonçait déjà, en 2013, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), y voyant là une mise à mal du « principe du contradictoire garant d’un procès équitable ».
Excès de précautions
Récemment, la CNCDH s’inquiétait également du recours fréquent au placement, dont de nombreuses études montrent qu’il est « trop souvent utilisé de manière abusive ». « Dans mes dossiers, 98,8 % des enfants ont été placés dès le signalement par l’hôpital », s’alarme l’avocat Grégoire Étrillard. Un principe de précaution devenu la norme, dans un système qui craint, plus que tout, de passer à côté d’une situation de maltraitance. « Depuis trente ans, la société n’a cessé de renforcer son seuil de vigilance. Le système s’est architecturé autour de cette idée qu’il faut “éviter le drame”. Et de plus en plus de parents ont l’impression qu’on agit trop fort, trop vite », concède Laurent Puech, travailleur social et ancien président de l’Association nationale des assistants de service social. Mais si ce « précautionnisme » prévaut aujourd’hui, rappelle-t-il, c’est aussi parce qu’il répond à une attente de la société. « D’un côté, on reproche aux professionnels de ne pas protéger assez les enfants, mais de l’autre, on leur reproche de prendre des précautions excessives. Il y a une attente paradoxale et, de fait, des objectifs impossibles à atteindre. »
* Le prénom a été modifié.
Lire aussi l Quand les placements abusifs d’enfants deviennent un délire conspi
Note de la rédaction : Dans un souci de lisibilité pour nos lecteur·rices, nous avons décidé de ne pas avoir recours à l’écriture inclusive pour l’édition de cette enquête, car elle en aurait trop alourdi la lecture.