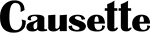Quatre ans après le (grand !) succès de son premier ouvrage, Tu seras un homme – féministe – mon fils !, Aurélia Blanc, journaliste à Causette, publie Tu seras une mère féministe !, un manuel d’émancipation pour aider les mères à survivre en terrain inégalitaire. Des daronnes qui, justement, se font de plus en plus entendre et repensent leur condition maternelle à l’aune des luttes féministes actuelles.

Causette : Le sujet de la maternité était-il un impensé du combat féministe ?
Aurélia Blanc : Globalement, oui. À la fin des années 1960, avec la deuxième vague, la question de la maternité était présente, mais avec l’idée de s’en libérer. Les luttes concernaient le droit à la contraception, l’accès à l’avortement ou le refus de l’exploitation domestique. La « maternité esclave » faisait figure de repoussoir et est toujours restée au second plan… et les mères aussi. Pourtant, certaines ont aussi milité. Mais elles racontent qu’elles se sont senties un peu en marge. Non seulement leur condition maternelle n’intéressait pas, mais on pouvait parfois leur faire sentir qu’elles avaient « trahi la cause ».
Depuis quelques années, une parole nouvelle autour de la maternité se fait entendre. Comment s’explique ce déclic ?
A. B. : Comme le dit la philosophe Camille Froidevaux- Metterie, on est entré dans le « tournant génital » du féminisme depuis les années 2010, avec des questions liées au corps, à l’intime. Les premières revendications fortes autour de la maternité ont d’ailleurs concerné les violences gynéco-obstétricales. Les réseaux sociaux, notamment Instagram, ont aussi joué un rôle essentiel. Beaucoup de mères ont saisi cet espace pour parler. Enfin, il y a eu aussi toute la vague des podcasts consacrés à la maternité, comme La Matrescence ou Bliss Stories. Tout ceci a trouvé un écho important dans une génération de femmes qui sont devenues mères alors qu’elles étaient, pour beaucoup, déjà féministes et assez alertes sur ces questions d’inégalités.
“Il faut en finir avec l’idée qu’on serait une ‘mauvaise féministe’ parce qu’à la maison, on vit des inégalités”
Mais qui se sont quand même pris une claque… Comment expliquer que, malgré une bonne connaissance des problématiques, le choc soit si grand ?
A. B. : On est l’une des premières générations ayant vécu avec des mères qui travaillaient massivement. On a aussi grandi avec l’idée que nous étions les égales des garçons et des hommes, que l’égalité était acquise. Or la maternité, qui est le moment où se cristallisent très fortement les inégalités entre les hommes et les femmes, vient faire voler ce mythe en éclats. C’est le moment des désillusions. Tu te retrouves assez seule, aux prises avec les questions de charge mentale et domestique, tu vois ton horizon professionnel se réduire… Ce qui n’est pas le cas des pères. Ce n’est pas un hasard si tant de femmes se découvrent (plus) féministes une fois qu’elles deviennent mères. Loin d’être une allégeance au patriarcat, la mater- nité est aujourd’hui un puissant catalyseur féministe.
Une fois ce constat posé, comment fait-on pour être une mère féministe au quotidien ?
A. B. : Le piège, ce serait d’en faire une injonction de plus : il faudrait déjà être une bonne mère, une bonne conjointe, une bonne amie, une bonne salariée et, en plus, une bonne féministe et une mère déconstruite. Or il n’y a évidemment pas de méthode miracle qui va rendre notre quotidien parfaitement égalitaire. Il faut en finir avec l’idée qu’on serait une « mauvaise féministe » parce qu’à la maison, on vit des inégalités. Ou que ce serait nous qui aurions « échoué » à nous émanciper, parce qu’on aurait fait le « mauvais choix » (de conjoint, par exemple). En réalité, tout cela s’inscrit dans une organisation sociale encore très patriarcale, avec des représentations très normatives sur les pères et les mères. Avoir une lecture féministe permet de comprendre que beaucoup de choses qu’on vit sur un mode individuel et qui font nous sentir dépassées ou un peu nulles ne sont pas le fruit de nos défaillances person- nelles. Nous ne sommes ni seules, ni nulles, ni folles : nous subissons les conséquences d’un système inégalitaire.
Le premier système auquel on se heurte, c’est le couple. Comment on peut agir dessus ?
A. B. : Les réflexions actuelles sur la sortie de l’hétérosexualité sont très stimulantes. Mais j’avais envie de m’adresser aux très nombreuses femmes qui vivent dans ce contexte du couple hétérosexuel – dont elles ne souhaitent ou ne peuvent pas nécessairement sortir. Là encore, ce n’est ni une simple affaire de volonté ni une question morale, où il y aurait d’un côté les méchants hommes qui exploiteraient leur compagne, de l’autre, les gentils qui seraient spontanément égalitaires. Notre organisation sociale joue à plein sur notre vie de couple. Ne serait-ce que sur le congé paternité ou le congé parental : tant que ce dernier ne sera pas mieux indemnisé, les hommes ne le prendront pas, et les inégalités domestico-parentales continueront de s’installer dès les premiers mois. Mais ce changement ne se fera pas sans l’implication des hommes. Selon un sondage réalisé en 2018, près de la moitié d’entre eux se disent féministes : pourquoi ne se mobilisent-ils pas, ou si peu, sur ces questions ?
“Notre société continue de survaloriser l’implication basique des pères comme si, par nature, ils étaient moins compétents sur le sujet”
Il y a un point qui cristallise beaucoup de colère, ce sont encore et toujours les tâches ménagères. Comment faire pour ne pas se faire avoir ?
A. B. : Le travail domestique, c’est LE nœud du problème. Pourtant, il y a assez peu de mobilisations collectives sur ce sujet – sans doute parce qu’il est douloureux d’admettre que notre couple n’est pas si égalitaire et que la figure de la ménagère est bien moins galvanisante que celle de la « femme puissante ». Toujours est-il qu’on n’avance pas sur cette question. Pas parce que les femmes ne savent pas « lâcher prise » ou déléguer, mais parce que plein d’hommes ne veulent pas en faire davantage et que c’est une source de conflit récurrent dans nombre de couples. Partant de là, il y a des femmes qui misent sur la pédagogie, partagent des lectures ou des podcasts avec leurs conjoints pour essayer de leur faire prendre conscience que ce n’est pas supportable. D’autres optent pour des outils pratiques, des applications de planification ou de partage des tâches. Et puis face à ces résistances masculines, certaines lâchent l’affaire ou, au contraire, finissent carrément par faire grève. Une témoin m’a raconté avoir stoppé toute activité domestique pendant quinze jours. C’était très dur, la culpabilité a été très forte vis-à-vis de ses enfants, mais c’était ça ou son couple explosait. D’ailleurs, pour d’autres, la solution est plus radicale : elles décident de se séparer. Et malgré toutes les difficultés que ça implique, elles disent ne pas regretter leur choix.
Passer des deals, expliquer à son partenaire ce qui ne va pas, lui ouvrir les yeux… C’est une charge mentale supplémentaire. On ne s’en sort plus…
A. B. : Certaines femmes ont l’énergie de mener cette bataille, et c’est très bien. Mais on est aussi légitimes à la refuser. Car c’est effectivement encore une charge en plus pour les mères. Sur le plan collectif, on aura fait un grand pas quand on arrêtera de ne parler de cette question qu’aux femmes et qu’on s’adressera aux hommes pour leur expliquer comment mieux s’organiser et « concilier ». Mais pour l’heure, notre société continue de survaloriser l’implication basique des pères – le fameux dad blessing – comme si, par nature, ils étaient moins compétents sur le sujet. Cette prétendue incompétence paternelle est bien pratique, car elle permet de continuer à se reposer sur les mères.
“Tous nos choix sont systématiquement soumis à jugement, y compris à jugement féministe”
Faut-il pousser les pères au premier plan ?
A. B. : Souvent, par commodité – car elle est en congé maternité ou parental, typiquement –, c’est la mère qui fait les papiers, les rendez-vous et se retrouve à être le parent référent. Mais même lorsque le père est présent, certaines racontent qu’on continue de ne s’adresser qu’à elles (par exemple chez le médecin), comme si elles étaient les seules légitimes. On fait face à une représen- tation très ancrée sur le rôle de la mère, encore perçue comme naturellement experte en parentalité. Et nous avons nous-mêmes intégré ces normes, donc ça nourrit notre propre moteur de culpabilité maternelle. Avoir une grille de lecture féministe permet de déculpabiliser et de se rendre compte qu’on n’est pas une mauvaise mère parce qu’on est un père comme les autres.
Comment expliquer que des femmes féministes, investies dans leur carrière, fassent des choix qui peuvent les pénaliser ? Comment faire
avec cet apparent paradoxe ?
A. B. : Cette question revient souvent. Une fois encore, on fait comme on peut dans un contexte donné. Certaines mères font le choix de travailler à temps partiel parce que leur rapport au travail a changé, qu’elles ne s’en sortent pas avec les doubles ou triples journées, ou simplement parce que ça leur convient mieux, tout en ayant conscience que ça entre en contradiction avec leurs idées. D’autres encore n’ont pas le choix, faute de mode de garde accessible. Et en cas d’arbitrage à faire sur un salaire, c’est souvent celui des femmes qui est sacrifié, puisque dans 75 % des couples, elles gagnent moins que leurs conjoints. Mais dans une perspective égalitaire, on pourrait par exemple imaginer que chacun des deux travaille à 80 %, plutôt que ce soit la mère qui passe à 60 %. Cela permettrait d’amoindrir les inégalités, y compris économiques.
Parmi les solutions, il peut y avoir celle d’une aide extérieure, pour les couples les plus favorisés. N’est-ce pas problématique, quand on est féministe, de déléguer la charge à d’autres femmes ?
A. B. : Il faut se sortir de la tête que ce sont les femmes qui délèguent la charge domestique ou la garde de leurs enfants pour pouvoir travailler. En réalité, c’est le couple qui délègue. Et nous sommes dans une société où on délègue tous le travail du care : quand nos parents vont à l’Ehpad, qu’on met nos enfants à la crèche, à la cantine… Ce qui doit nous mobiliser, c’est notre organisation sociale qui déconsidère cet indispensable travail de care. Mais il me semble qu’on ne peut pas blâmer individuellement les parents qui délèguent une partie de ce travail. D’ailleurs, si les mères s’arrêtent de travailler pour prendre en charge ce travail de care, on leur dira que c’est pas non plus très féministe. Tous nos choix sont systématiquement soumis à jugement, y compris à jugement féministe.
“Je pense qu’on doit refuser de nourrir la compétition maternelle. Quels que soient nos choix, on a toutes intérêt à se soutenir”
Le jugement, c’est un énorme poids pour les mères…
A. B. : Oui, un tas de femmes m’ont dit qu’elles n’auraient jamais imaginé que le jugement serait aussi dur envers elles, qu’elles avaient l’impression d’être toujours sur la sellette. C’est une période où on se pose déjà énormément de questions et s’ajoutent à ça les remarques continuelles, les regards désapprobateurs dès lors qu’on met un pied dans l’espace public avec des enfants. Prendre conscience que quoi qu’on fasse, on sera toujours jugées, toujours suspectées d’en faire trop ou pas assez, permet de se lâcher un peu les baskets. Pour résister à cette pression, je crois aussi qu’il faut cultiver une certaine solidarité. Certaines racontent qu’elles ont développé une forme d’éthique de solidarité envers les autres mères dans l’espace public. Par exemple en intervenant lorsqu’elles voient une autre mère essuyer des commentaires désobligeants. Plus largement, je pense qu’on doit refuser de nourrir la compétition maternelle. Quels que soient nos choix, on a toutes intérêt à se soutenir et à ne pas rentrer dans ce jeu-là – dans lequel nous sommes, finalement, toujours perdantes.
Tu seras une mère féministe ! Manuel d’émancipation pour des maternités décomplexées et libérées. Marabout, 308 pages. Sortie le 21 septembre.
Tu seras un homme – féministe – mon fils ! Manuel d’éducation antisexiste pour des garçons libres et heureux. Marabout, 224 pages. 2018.