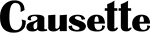Des victimes de Georges Tron aux violences sexuelles dénoncées par Judith Godrèche, le consentement est la pierre angulaire des affaires de viol. La notion pourrait être introduite dans la définition pénale française, mais les juristes restent divisé·es quant aux changements réels de cette mesure sur le traitement des plaintes.
“C’est une très bonne nouvelle que les choses bougent”, réagit auprès de l’AFP Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à l’université Paris-Nanterre, après des propos en ce sens d’Emmanuel Macron. Le 8 mars, le chef de l’État a exprimé son intention de faire évoluer la notion de consentement, alors que la France s’oppose depuis des mois à une définition européenne du viol basée sur le consentement et visant à rapprocher la réponse pénale des vingt-sept pays membres.
Si revirement il y a, la question restera “la traduction de cette annonce dans la loi : il ne suffira pas d’ajouter le mot consentement, mais il faudra porter une réforme vraiment réfléchie”, estime Audrey Darsonville. “Pas de poudre de perlimpinpin”, abonde Me Élodie Tuaillon-Hibon, qui réclame l’inscription du consentement pour “contraindre les juges à examiner l’accord libre et éclairé en fonction des circonstances”.
Actuellement, le terme ne figure pas dans la définition française, qui entend par viol “tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise“.
Les partisan·nes d’une inscription soutiennent qu’elle contraindrait les procureur·es à caractériser si et dans quelle circonstance le consentement a été donné, s’il est éclairé et valable. “Ce que l’on veut”, explique Me Tuaillon-Hibon “c’est que la France remplisse ses obligations nationales et inscrive [dans les textes français] le texte de la convention d’Istanbul”, signée en 2011 par le Conseil de l’Europe et dont l’article 36 précise que le viol et tout acte sexuel sans consentement mutuel sont considérés comme des infractions.
Pour les sceptiques, en revanche, si la notion est incluse, une possible complication dans le recueil des preuves est à prévoir. Le risque pour ses opposant·es est aussi celui de déplacer le curseur sur la victime dont le comportement serait passé au tamis judiciaire.
Changement du droit, un “faux débat” ?
Les procédures actuelles se focalisent sur les éléments matériels et intentionnels de
l’agresseur dénoncé, en s’appuyant sur les quatre critères qui définissent le viol. “J’ai beaucoup d’appréhension sur le fait que ce texte, à force de surajouts et de réformes, devienne de plus en plus nébuleux” et ne soit “affaibli”, redoute l’avocate pénaliste Marie
Dosé. L’introduction risquerait aussi de “contenir les prémices d’un renversement de charge de la preuve qui serait contreproductif, et je sais à quel point en défense on se réfugie derrière cette notion de consentement alors que le texte n’y renvoie pas explicitement”, déclare l’avocate, selon qui “cette question est suffisamment grave pour qu’elle mérite un autre traitement qu’un micro-trottoir présidentiel”.
“Si le mot n’est nulle part, l’idée du consentement est partout dans ces dossiers”, souligne par ailleurs un magistrat, sous couvert d’anonymat. “C’est ce qu’on explique aux jurés populaires et cela revient souvent durant les procès.” Les notions de “violence, menace ou surprise” ont en outre été étendues de façon considérable par la jurisprudence, relèvent plusieurs professionnel·les.
Pour Fabienne Averty, secrétaire nationale de l’Union syndicale des magistrat·es, inclure la notion de consentement n’améliorerait pas nécessairement la difficulté des victimes à recueillir des preuves. Néanmoins, cela “pousserait notre société à évoluer vers une autre façon d’aborder la sexualité”, ajoute-t-elle.
“Sur le fond, en droit”, prouver le non-consentement, lorsque la victime est en état de sidération, est particulièrement complexe, prend-elle comme exemple. “Ce qu’il faut surtout, c’est des enquêteurs et du temps pour mettre en confiance la victime et recueillir sa parole, du temps pour entendre des témoins, notamment pour les questions d’emprise”, ajoute-t-elle. Me Laure Heinich, qui défend beaucoup de victimes, affirme que l’on assiste à “un faux débat”. Le problème “n’est pas la loi […], mais l’absence d’enquête”, estime-t-elle. “Le taux de classement sans suite n’est absolument pas en relation avec le problème de preuves. Les 80 % des plaintes qui sont classées le sont car elles ne sont pas enquêtées.”
Finalement, pour réduire “l’écart assez effrayant entre le nombre de plaintes et le nombre de condamnations”, “il faudra plus qu’un simple mot”, estime pour sa part Nelly Bertrand, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature.