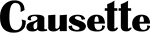Ces dernières années, le débat autour de l’inclusion des personnes trans et de leurs combats dans le mouvement féministe fait rage sur les réseaux sociaux. Les dissensions se sont invitées dans la rue, sous forme de slogans d’abord. Et puis, le 7 mars dernier, féministes radicales et militant·es trans en sont venu·es aux mains. Une animosité semblant aller crescendo qui inquiète autant qu’elle interroge : pourquoi une telle violence et surtout, jusqu’où ira-t-elle ?
C’est une bataille qui se jouait jusque-là sur les réseaux sociaux ou à coups de slogans peints sur les murs. Mais le 7 mars dernier, lors d’une manifestation en marge de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes, l’affrontement entre militant·es trans et féministes radicales est devenu physique. À l’appel du collectif d’associations féministes On arrête toutes, un rassemblement est organisé place de la République à Paris. Environ trois cents personnes, principalement des femmes, sont réunies. Mais rapidement, deux groupes se forment. D’un côté, des féministes du collectif Antifa Paris Banlieue, munies de banderoles « féministes antifascistes contre l’islamophobie », « personnes trans, féministes et légitimes ». Des slogans très ciblés qui ne visaient pas tant la société patriarcale que le groupe de féministes qui leur faisait face de l’autre côté. À savoir : une vingtaine de militantes des collectifs Abolition Porno Prostitution (CAPP) ou de L’Amazone. Perchées sur la statue de Marianne, ces militantes ancrant leur combat dans les pas du Mouvement de libération des femmes (MLF) sont elles aussi munies de banderoles exprimant leur vision du féminisme : « Si ton féminisme profite aux proxénètes, ce n’est pas du féminisme. » Et surtout « Vive le sexe féminin ». Une allusion directe aux femmes trans, qui voient leur présence au sein du mouvement féministe remise en question par ces militantes.
La conception restrictive du combat des héritières des luttes seventies leur vaut l’acronyme de « Terf ». Un anglicisme signifiant Trans-exclusionary radical feminist. Ou en français : des féministes radicales excluant les personnes trans. Une terminologie utilisée pour la première fois en 2008 par Viv Smythe, militante féministe australienne. Elle l’emploie pour dénoncer le festival de musique Michigan Womyn’s Music Festival qui exclut les femmes trans des espaces « réservés aux femmes ». Si le mot est depuis entré dans le jargon militant, il est jugé comme péjoratif, voire insultant, par les militantes féministes radicales qu’il qualifie. Elles préfèrent le terme « critique du genre ».
Rapidement, le ton monte. « Cassez-vous » ; « Fascistes », sont scandés comme une rengaine par les trans et leurs allié·es. Encerclant la statue, certain·es miment de lancer une bouteille de bière sur les féministes « radicales », toujours perchées sur le piédestal de Marianne. Ce sont finalement des œufs qui font office de projectiles, forçant les membres de L’Amazone et de CAPP à quitter la manifestation sous l’escorte du service de sécurité de la Ville, du service d’ordre d’Osez le féminisme (OLF) et sous les insultes des militant·es du camp adverse. Pour le combat égalitariste qui rassemble place de la République l’ensemble des manifestant·es, l’image est délétère : ainsi donc, des féministes parviennent à s’écharper entre elles plutôt que de faire front contre l’ennemi commun qu’est le patriarcat.
Transphobie et féminisme, une vieille histoire
On peut plus ou moins situer l’amorce de ce conflit en France au début de l’année 2020. Le 22 janvier, Marguerite Stern, féministe radicale et initiatrice du mouvement des « colleuses », poste une série de tweets : « La première chose, c’est que je trouve que les débats sur le transactivisme prennent de plus en plus de place dans le féminisme, et cristallisent même toute l’attention. J’interprète ça comme une nouvelle tentative masculine pour empêcher les femmes de s’exprimer. » Elle réagit à la publication d’un post Instagram du collectif de colleur·euses de Montpellier. On peut y voir le collage suivant : « Des sisters pas des cisterfs. »
Très vite, ce positionnement de Marguerite Stern est perçu comme transphobe par une partie des féministes et la communauté LBGTQIA+. De quoi raviver de vieux débats. Pour Maud-Yeuse Thomas, cofondatrice du site L’Observatoire des transidentités, cette dissension apparaît aux États-Unis dans la décennie 1970. « Cela va se solder par l’écriture, en 1979, d’un bouquin qui est très célèbre dans nos communautés. Celui d’une écrivaine américaine, Janice Raymond : L’Empire transsexuel. » Pour l’autrice américaine, la transidentité serait basée sur des « mythes patriarcaux », renforcerait les stéréotypes de genre et serait faite pour « coloniser l’identification féministe, la culture, la politique et la sexualité ». Une vision jugée transphobe par des membres de la communauté LBGTQIA+, mais qui va faire son nid dans certains cercles de féministes radicales. Elle inspirera notamment d’autres militantes, comme la Française Patricia Mercader, qui publie en 1994 L’Illusion transsexuelle. Dans son livre, l’autrice interroge médecins, psychanalystes, féministes, sociologues, juristes et « transsexuel·les », pour essayer de comprendre les causes du « phénomène transsexuel ».
« Il y a aujourd’hui une plus grande couverture médiatique de ces questions-là et donc une plus grande conscience dans la population générale et dans le féminisme »
Constance Lefevbre, militante féministe et ancienne Femen
Une transphobie qui ne trouve que tardivement une véritable opposition. Il faut attendre les années 2000 et l’avènement d’Internet pour voir l’émergence de mouvements militants trans. « On va avoir des groupes qui mettent en place des revendications beaucoup plus formelles et se donnent les moyens d’agir dans l’espace public », note Karine Espineira sociologue et cofondatrice de L’Observatoire des transidentités. Conséquence : « Il y a aujourd’hui une plus grande couverture médiatique de ces questions-là et donc une plus grande conscience dans la population générale et dans le féminisme », complète Constance Lefebvre, militante féministe et ancienne Femen. De son côté, Marguerite Stern assure à Causette : « La question des personnes trans, je ne me l’étais jamais posée avant qu’elle ne déborde complètement dans la sphère du féminisme et que je n’entende plus parler que de ça. »
Le genre : un concept, deux visions
Depuis peu, les dissensions semblent avoir atteint un point de non-retour. Exemple avec ce slogan tagué (et depuis effacé) le 7 mars dernier, au pied de la statue de Marianne : « Sauve 1 trans, bute 1 terf. » En fait, la présence des personnes trans au sein du mouvement féministe soulève une question quasi philosophique : qu’est-ce qu’être une femme ? Est-ce, comme l’entend le courant féministe matérialiste et radical, avant tout une condition subie, due à l’assignation d’un genre en raison de son sexe de naissance ? Ou, comme l’envisage le mouvement trans, un ressenti qui permet à une personne de s’intégrer à la communauté des femmes à partir du moment où elle s’identifie femme ?
Le sujet déchire mais s’inscrit pourtant dans une certaine continuité du mouvement féministe. C’est le constat que fait Christine Bard, professeure à l’université d’Angers, spécialiste de l’histoire des femmes et du genre : « Les féminismes ont toujours interrogé la catégorie “femmes” : pour certaines, elle renvoyait à une fonction sociale majeure, la maternité, jugée insuffisamment reconnue par la société patriarcale ; pour d’autres à l’individu. Simone de Beauvoir disait « la femme est un homme comme les autres ». Historiquement, les débats ont été vifs, opposant une définition naturaliste, essentialiste, biologisante de la féminité et une définition constructiviste. Avant même l’emploi du mot genre, des féministes comme Madeleine Pelletier souhaitaient, à travers la théorie de la virilisation des femmes, effacer la différence sexuelle. Nous dirions aujourd’hui “abolir le genre”. Le mouvement trans prolonge en ce sens des débats déjà anciens. »
Deux visions s’opposent. La première est issue des courants matérialistes ou universalistes : être une femme est un fait biologique. Est considérée comme femme toute personne née avec un vagin, un utérus et la capacité de donner la vie. Pour Christine Delphy, sociologue et fondatrice du Mouvement de libération des femmes (MLF) : « Le genre précède le sexe. Comme dans la société les gens ne veulent pas reconnaître que le genre est une construction sociale, ils ont recours à la biologie. Mais elle ne joue pas un grand rôle, si ce n’est de rappeler aux petits garçons qu’ils ont un petit pénis et aux filles qu’elles n’en ont pas. » Mais sexe et genre n’en restent pas moins liés, considère Christine Delphy, rendant ce dernier immuable : « Le genre, c’est l’identité de la personne et on ne peut s’en débarrasser comme ça. C’est quelque chose qui nous formate et qu’on ne peut pas soi-même changer. C’est ce que la société a instauré et elle n’est pas prête à le laisser tomber. » Une vision très répandue dans le féminisme de la deuxième vague et notamment au sein du MLF. Des féministes de la jeune génération – comme Marguerite Stern, Pauline Arrighi ou Dora Moutot – partagent cette conception où le sexe définit le genre. De là découlent les inégalités. « Les femmes ont toujours été oppressées, ont toujours dû se battre à travers leurs luttes contre une oppression basée sur le sexe et sur la réalité biologique de leur corps. La prostitution, le harcèlement de rue, les violences sexuelles obstétricales, l’IVG, l’excision, la question de l’égalité salariale, toutes les oppressions sont centrées autour de notre corps. Pour moi, c’est hyper important de reconnaître qu’une femme, c’est ça », explique à Causette Marguerite Stern.
« En France, on a des représentations des femmes trans qui sont obsolètes, qui datent des années 1980 »
Karine Espiniera
De l’autre côté, les féministes inclusives ou intersectionnelles refusent de restreindre à la biologie l’identité féminine. C’est une question de perception et de ressenti plus que d’organes génitaux. Le genre serait fluide puisqu’il n’est pas seulement lié à notre biologie.
Un concept qui heurte les féministes matérialistes radicales, pour qui en changeant de genre et en s’appropriant celui du sexe opposé, les personnes trans renforceraient les stéréotypes de genre, contre lesquels elles se battent précisément. Un argumentaire qui, pour Karine Espineira, relève d’une vision stéréotypée et datée de ce que sont aujourd’hui les personnes et notamment les femmes trans : « On est une génération qui ne se maquille jamais, qui ne met pas de talons hauts parce que c’est super désagréable. Même les soutiens-gorge, on n’en veut pas, parce que ça fait mal ! Tout ça fait partie d’imaginaires et de caricatures qui ont été socialement répandus et qui ont la vie dure. En France, on a des représentations obsolètes qui datent des années 1980. » Exemple suprême, observe Karine Espiniera, que la diffusion de stéréotypes n’est pas du fait des femmes trans : le clan Jenner-Kardashian. Au sein de la famille star de la téléréalité américaine, Caitlyn Jenner, père de Kendall et Kylie Jenner et ancienne sportive de haut niveau, a entamé une transition en 2015. « Quand je donne des conférences, je montre au public des photos de l’ensemble de la famille et je demande qui renforce les stéréotypes sur les femmes. C’est juste qu’on focalise sur l’expression de genre des personnes trans », s’exaspère-t-elle. En effet, que ce soit Kendall et Kylie, leurs demi-soeurs Kourtney, Kim et Khloé ou leur mère, Kris, toutes s’affichent sur Instagram surmaquillées, chaussées de talons hauts, de robes et de tout ce que la société peut juger de « féminin ». Ainsi, au sein de la famille Jenner-Kardashian, ce n’est pas la femme trans qui renforce les stéréotypes de genre, mais bien les femmes cis.
Alors pour affirmer leur soutien aux militant·es trans, le 26 février 2020, dans Libération, des dizaines de personnes ont signé une tribune du collectif « Toutes des femmes ». Elles y affirmaient ainsi que : « Nous refusons qu’une femme ait à apporter des preuves de féminité. Nous, femmes, transgenres ou cisgenres, féministes, refusons l’importation de ces débats transphobes en France. »
Canada, Royaume-Uni, France ou États-Unis : même combat
Car ce clivage autour de l’inclusion des personnes trans n’est pas une exclusivité française. Il se développe notamment dans les pays anglo-saxons, au moment où les questions sur la transidentité font irruption dans la loi. Ce fut le cas au Royaume-Uni, en 2016, lorsqu’un comité de la Chambre des communes du Parlement, le Women and Equalities Committee (Le Comité des femmes et de l’égalité) propose de revoir le Gender Recognition Act (loi sur la reconnaissance du genre) afin de faciliter le changement d’état civil pour les personnes trans. « C’est globalement ce qui a lancé le mouvement gender critical, [en français, critique de la notion de genre, ndlr] selon lequel le genre est lié au sexe biologique et n’est donc pas fluide », estime Constance Lefebvre. Parmi les opposants les plus virulents : LGB Alliance. Cet organisme crée au Royaume-Uni en 2019 entend promouvoir les droits des « lesbiennes, bisexuel·les et des gays, ainsi reconnus par leur sexe biologique » et les protéger de « nouvelles idéologies qui confondent sexe biologique et notion d’identité de genre, remplaçant “sexe” par “genre” ». Les associations LGBTQIA+ dénoncent régulièrement la transphobie de ce groupe qui se présente sur Twitter avec le hashtag #SexNotGender. La loi ne sera finalement pas adoptée.
« Au Canada, il y a eu la même chose avec la loi C‑16 en 2016 qui a amorcé le mouvement gender critical avec Meghan Murphy notamment, une féministe créatrice du site Feminist Current, connu pour ses propos jugés transphobes » poursuit Constance Lefebvre, signataire de la tribune de « Toutes des femmes ». Ce projet de loi adopté en 2017 vise à « protéger les personnes contre la discrimination dans les champs de compétence fédérale et contre la propagande haineuse, quand celles-ci mettent en cause l’identité ou l’expression de genre ».
Ghislaine Gendron, membre de l’association Pour les droits des femmes du Québec, a fait partie de celles qui s’y sont opposées. Contactée par Causette, elle explique : « Le C‑16 interdisait la discrimination faite sur l’identité de genre. Je n’ai pas de problème avec ça. Là où le bât blesse, c’est l’interprétation qu’en font les administrations publiques. Elles interprètent la loi sur les discriminations et substituent le sexe à l’identité de genre, ce qui cause du tort aux femmes, estime-t-elle. Avant, la lutte féministe défendait les droits des femmes. Aujourd’hui, il y a ce que j’appelle un détournement de mission. Il ne faut pas noyer le combat pour les femmes dans la défense des personnes trans : il faut continuer à défendre les droits des LGBT, donc des hommes bisexuels, des hommes gays, des hommes et des femmes trans mais à côté, pour ne pas empiéter sur les revendications particulières aux femmes. »
Ghislaine Gendron fait part de l’une des inquiétudes au cœur de l’argumentaire des « critiques du genre » : voir le droit des femmes reculer et leur cause invisibilisée. On le voit d’ailleurs aux États-Unis, appuie Constance Lefebvre : « En janvier 2021, le Parti démocrate a introduit une proposition de loi, l’Equality Act qui vise à constitutionnaliser l’égalité entre femmes et hommes. L’opposition à cette loi joue avec la transphobie : l’idée que sous couvert de lutter pour l’égalité, les démocrates mettraient en danger les femmes en donnant des droits aux personnes trans. » Celles qui ont brandi cet argument selon lequel le combat pour les droits des trans ferait de l’ombre à la lutte pour les droits des femmes sont d’ailleurs trois organisations conservatrices : le Parti républicain, Heritage Foundation, Alliance Defending Freedom.
Un dialogue possible ?
Les « critiques du genre » ont un autre cheval de bataille : la participation des femmes trans aux compétitions sportives féminines, qui, selon elles, mènerait à une compétition inégale. Le 17 mars, un sous-amendement visant à « consacrer le principe d’égalité sportive des personnes trans dans la pratique sportive », porté par le député LREM Raphaël Gérard, a été adopté à l’Assemblée dans le cadre de la proposition de loi pour démocratiser le sport. Colère de Marguerite Stern, qui signe dans Marianne, le 23 mars, une tribune intitulée : « Reconnaître l’identité de genre dans une compétition sportive entre en contradiction avec le fait de reconnaître le sexe. » À Causette, elle explique :« Au-delà du sport, je parle de la façon dont cette idéologie-là peut léser les droits des femmes. Pour la première fois, elle est en train d’entrer dans la loi en France. C’est une étape qui est en train d’être passée. On ne parle plus de débat de niche, maintenant, on parle de légiférer. »
Pourtant, des points de dialogue entre féministes radicales et militant·es trans sont possibles. Notamment au sujet de la construction sociale du genre. Pour les « critiques du genre », un homme ne peut devenir une femme (et inversement), car il ne se défera jamais de l’éducation qu’il ou elle a reçue et qui façonne son rapport à la société. Ça a l’air agressif comme ça, mais même Karine Espineira admet qu’il y a matière à réflexion : « Je ne suis pas contre tous les arguments des matérialistes. Par exemple, la question de l’éducation est quelque chose qui me fait réfléchir. On peut se demander ce qu’une éducation pendant dix, vingt ou quarante ans en tant qu’homme peut laisser comme traces ensuite. En quoi cela va imprégner la personnalité des personnes, quand bien même elles transitionneraient ? Le problème, c’est que cet argument est souvent posé comme une condamnation. Pas comme une ouverture à la discussion et au débat. »
Surfocalisation
Alors d’où vient cette peur ? Pour Karine Espineira, c’est une question d’agenda et de surfocalisation. « Dans l’agenda des luttes, il y a eu le mariage pour tous, puis la question de l’état civil des trans. Cela a occupé l’espace médiatique et militant, donnant l’impression que les autres luttes devenaient invisibles. Mais ce n’est pas nouveau, cela s’est vu il y a quelques années dans les milieux lesbiens féministes. Quand les centres gays et lesbiens sont devenus des centres LGBT, il y avait cette peur que les questions trans invisibilisent les questions gays et lesbiennes. Alors que bien souvent, c’était un T de façade. Il n’y avait rien derrière. »
« Dans le mouvement féministe actuel, surtout en ce moment, la question trans est énorme.
Christine » Bard, professeure d’histoire contemporaine
Et si finalement ce conflit était avant tout générationnel ? Car si certaines jeunes féministes critiques du genre se revendiquent matérialistes, un courant très présent dans la deuxième vague féministe des années 1970, nous sommes aujourd’hui dans la quatrième vague. Laquelle se caractérise par un féminisme intersectionnel, où convergence des luttes entre personnes racisées, précaires, trans ou cis, hétéros ou homos est le mot d’ordre. C’est ce qu’analyse Christine Bard avec son regard de professeure d’histoire contemporaine : « Dans le féminisme actuel, surtout en ce moment, la question trans est énorme. Elle prend une place qui fait controverse si l’on juge que c’est au détriment d’autres combats, comme l’égalité des salaires ou le partage du pouvoir politique. Dans les sociétés occidentales qui n’ont fait qu’une place mineure au « 3e sexe », elle interpelle aussi sur les fondations cisgenres de notre société, sur ce que sont le sexe et le genre, les assignations identitaires, l’organisation sociale en deux classes de sexe et de genre. En ce sens, la question trans va bien au-delà de la revendication de droits pour une minorité. »
Alors à quoi ressemblera le féminisme dans cinq ou dix ans si ce conflit continue de s’intensifier ? Si les plus optimistes pensent qu’il se résorbera de lui-même, une chose est sûre : cette guerre interne profite au moins à une catégorie de la population : les antiféministes et autres masculinistes, qui se délectent de cette guerre sororicide. Preuve en images avec une sélection (non exhaustive) de commentaires trouvés sur un forum de Jeuxvideos.fr.