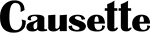Le 6 juin 1944, les américains débarquent en Normandie, certes. Mais ils violent aussi des Françaises. La plupart des femmes n’ont pas osé rapporter ces crimes de guerre à l’époque. À l’approche des célébrations de l’événement historique, leurs familles ne veulent plus se taire : des femmes témoignent aujourd’hui pour leurs mères, leurs soeurs.
Malgré l’image libératrice collée à la peau des soldats américains, de nombreuses femmes ont été traumatisées par leur arrivée en Normandie le 6 juin 1944. C’est le cas d’Aimée. Elle a 19 ans à l’époque et vit dans un petit village de Bretagne, à Montours. Comme tous et toutes ses voisin·es, elle se réjouit de l’arrivée de ces “libérateurs”, qui annonce la fin de l’occupation allemande. Mais très vite, elle déchante. Le soir du 10 août, deux GI – le surnom donné aux soldats américains – entrent dans la ferme familiale. “Ils étaient ivres et il leur fallait une femme”, résume pudiquement Aimée, désormais âgée de 99 ans.
D’un meuble ancien, elle tire une lettre que sa mère, Aimée Helaudais Honoré, a écrite à sa
fille, “pour ne rien oublier”. D’une écriture soignée, la fermière raconte d’abord comment les soldats ont tiré sur son mari, les balles trouant son béret, puis se sont dirigés, menaçants, vers sa fille. “Je suis sortie pour la protéger et ils m’ont emmenée dans les champs. Ils m’ont violée quatre fois chacun, en tournant”, retrace-t-elle dans sa lettre.
La voix de sa fille se brise en la lisant, quatre-vingts ans plus tard. “Oh, maman, tu as souffert, et moi aussi, j’y pense tous les jours”, murmure-t-elle. “Maman s’est sacrifiée pour me protéger. Pendant qu’ils la violaient, nous attendions dans la nuit sans savoir si elle reviendrait vivante ou s’ils la fusilleraient”, se rappelle-t-elle. En octobre 1944, à la fin de la décisive bataille de Normandie, les autorités militaires américaines ont jugé 152 soldats pour le viol de femmes françaises. Un nombre “largement sous-estimé”, affirme Mary Louise Roberts, l’une des rares historiennes à s’être penchée sur ce “grand tabou de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de femmes ont préféré se taire : en plus de la honte liée au viol, l’atmosphère était à la joie, à la célébration des libérateurs”, explique-t-elle.
Le viol comme récompense pour les américains
Pour motiver les G.I. à combattre si loin de chez eux, “l’armée leur a promis une France
peuplée de femmes faciles”, souligne la spécialiste américaine. Le journal Stars and Stripes, publié par les forces armées américaines et lu avidement par les milliers de soldats déployés en Europe, regorge de photos de Françaises embrassant les libérateurs. “Les Françaises sont folles des Yankees [surnom donné aux soldats américains de la 26e division d’infanterie pendant la guerre, ndlr] […] voilà ce pour quoi nous nous battons”, titre le journal le 9 septembre 1944.
“La perspective du sexe motivait les soldats américains à combattre. Et c’était, notamment via la prostitution et le viol, une manière de dominer la France, dominer les hommes français qui avaient été incapables de protéger leur pays et leurs femmes face aux Allemands“, explique Mary Louise Roberts. “On peut estimer que des centaines, voire des milliers d’autres viols par des soldats américains n’ont pas été signalés entre 1944 et le départ des G.I. en avril 1946“, rapporte-t-elle.
La peur de ne pas être crue
Non loin de Brest, Jeanne Pengam, 89 ans, se souvient “comme si c’était hier” du viol de sa sœur aînée, Catherine, et du meurtre de son père par un GI “L’Américain noir, il voulait violer ma grande sœur. Mon père s’est interposé et le soldat l’a abattu. Le bonhomme a réussi à détruire la porte et à rentrer dans la maison”, raconte-t-elle, entourée de ses nièces.
Alors âgée de 9 ans, la petite fille court avertir une garnison américaine (un groupe de soldats) postée à Loc Maria, à quelques kilomètres. “J’ai dit que c’était un Allemand, je me suis trompée. Quand ils ont vu les balles le lendemain, ils ont tout de suite compris que c’était un Américain”, relate-t-elle.
La sœur de Jeanne, Catherine, gardera en elle “ce secret qui l’a empoisonnée toute sa vie” jusqu’à l’approche de sa mort, confie Jeannine Plassard, l’une de ses filles. “Sur son lit d’hôpital, elle m’a dit : ‘J’ai été violée pendant la guerre, à la Libération’. Je lui ai demandé : ‘As-tu réussi à en parler à quelqu’un ?’ Elle m’a dit : ‘En parler à quelqu’un ? Mais c’était la Libération, tout le monde était content, je n’allais pas raconter quelque chose comme ça, je n’allais pas être crue !’”
Les GI noirs davantage condamnés
Dans son livre OK Joe !, paru en 1976, l’écrivain Louis Guilloux parle de son expérience
comme traducteur au sein des troupes américaines après le Débarquement. Notamment affecté aux procès pour viol de GI par des tribunaux militaires américains, il remarque que “ceux condamnés à mort sont quasiment tous noirs”, souligne Philippe Baron, auteur d’un documentaire sur ce roman, et d’un ouvrage, La Part d’ombre de la Libération.
Ces GI seront ensuite pendus sur les places publiques des villages français, comme ce fut le
cas pour les violeurs d’Aimée Helaudais, la mère d’Aimée Dupré et Catherine Tournellec, la sœur de Jeanne Pengam. “C’est une histoire à tiroirs”, souligne Philippe Baron. “Derrière le tabou du viol par des libérateurs, il y a le secret honteux d’une armée américaine ségrégationniste […] parfois aidée par des autorités locales racistes. Une fois devant la cour martiale, un soldat noir n’avait quasi aucune chance d’être acquitté. Il y a là quelque chose de terriblement actuel car, aujourd’hui encore, les hommes noirs sont présumés coupables devant la justice”, note-t-il.
Une addition de clichés racistes
Mary Louise Roberts, autrice du livre Des GI et des femmes fait le constat suivant : lorsque le commandement militaire réalise que “la situation est hors de contrôle”, il “choisit de faire des soldats noirs les boucs émissaires afin de transformer le viol en crime noir […] pour absolument maintenir la réputation des Américains blancs”. Les statistiques sont “stupéfiantes” : entre 1944 et 1945, sur vingt-neuf soldats condamnés à mort pour viol, vingt-cinq sont des GI noirs, pendus par “un bourreau venu exprès du Texas.”
“L’armée expliquait cela par le fait que le Noir était un violeur en puissance, qu’ils avaient une sexualité exacerbée, un stéréotype raciste du Sud” des États-Unis, note-t-elle.
“En réalité, les GI noirs étaient souvent affectés à des unités de logistique, durablement
stationnées au même endroit, avec donc davantage de contact avec la population locale, y
compris les femmes. Les soldats blancs, eux, étaient dans des unités mobiles. Ils pouvaient violer une Française le soir et repartir dès le matin, sans être jamais arrêtés. Et si c’était le cas, le témoignage de la victime était le plus souvent remis en cause”, remarque l’historienne.
Placée sous surveillance policière en 2013 après la publication de son livre Des GI et des
femmes, Mary Louise Roberts estime que, quatre-vingts ans après le Débarquement, “le mythe du GI perdure. La Seconde Guerre mondiale, c’est LA bonne guerre, puisque toutes les guerres menées depuis par notre gouvernement ont été des défaites morales, comme le Vietnam ou l’Afghanistan”, analyse l’historienne. “Personne ne veut perdre ce héros américain qui nous rend fiers : le brave et intègre GI américain, protecteur des femmes”, note-t-elle. “Quitte à perpétuer le mensonge”, conclut-elle.