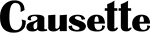Jamais reconnu par la communauté scientifique, le « syndrome d’aliénation parentale » est pourtant fréquemment invoqué devant les tribunaux. Une influence que l’on doit pour beaucoup aux masculinistes, qui ont trouvé là une arme parfaite pour occulter la question des violences conjugales.
« J’étais devenue la bonne à tout faire. Il me rabaissait tout le temps, il buvait, j’avais toujours peur qu’il se mette en colère », se souvient Jade 1, 43 ans. Marocaine ayant grandi en France, elle a 27 ans lorsqu’elle se marie avec un homme, lui aussi marocain, qu’elle connaît depuis quelques mois seulement. Très vite, « la vie commune devient de pire en pire » : son mari, qui a exigé qu’elle arrête de travailler, lui interdit aussi de prendre une contraception. Entre 2005 et 2007 naissent alors trois enfants. « Je n’avais pas d’argent, pas de téléphone portable, pas de logement où aller. J’étais prisonnière », résume aujourd’hui cette brune volubile. Après une première tentative de fuite avortée, elle finit par partir avec ses enfants, porte plainte et demande le divorce, au printemps 2014. C’est là, dit-elle, que « les ennuis commencent ».
La plainte de Jade ayant été classée sans suite, la justice ne se prononce pas sur les violences conjugales : pour elle, Jade et son époux vivent un simple « conflit parental ». Afin de pouvoir déterminer si leurs enfants sont en danger avec l’un ou l’autre, la justice ordonne alors une enquête sociale, puis une seconde, à laquelle vient s’ajouter une mesure d’investigation judiciaire. Pendant ce temps-là, Jade, qui a la garde des enfants, dit subir le harcèlement de son ex-conjoint. Ce dernier a d’ailleurs écopé, en 2017, d’un rappel à la loi pour des faits de violences sur conjoint, comme le révèle une ordonnance judiciaire que nous avons pu consulter. Cette ordonnance, qui reprend les conclusions de l’enquêteur social, souligne aussi que les « enfants montrent une réelle crainte de voir leur père ». Ce qu’avait déjà relevé le juge des enfants, début 2018, indiquant dans son ordonnance que « chacun [d’entre eux] semble avoir été marqué par les manifestations de colère de leur père dont ils ont été témoins ».
Ce qui explique peut-être pourquoi l’aîné, aujourd’hui âgé de 14 ans, refuse aujourd’hui de voir son paternel. Tout comme sa sœur de 13 ans, qui affirme que celui-ci l’aurait sexuellement touchée en 2017 : si sa plainte (que nous avons pu consulter) a elle aussi été classée sans suite, l’attestation rédigée par sa psychologue dans le cadre de l’enquête sociale fait, elle, état d’un « stress post-traumatique ». Quant au petit dernier, 12 ans, il dit vouloir garder un lien avec son père. Ce qu’a accepté le juge aux affaires familiales, qui a néanmoins statué en faveur de visites médiatisées (c’est-à-dire encadrées par des professionnel·les de la protection de l’enfance). « Aujourd’hui, la parole des enfants commence à être entendue », souffle Jade. Mais cinq ans et demi après la séparation, le divorce – qui relève ici du droit marocain – n’est toujours pas prononcé. Et l’avocate de son ex-conjoint continue d’accuser Jade d’ « instaure[r] un syndrome d’aliénation parentale ». Autrement dit, si ses enfants ne veulent plus voir leur père, ce n’est pas parce que celui-ci serait violent : c’est parce que Jade leur aurait fait un lavage de cerveau.
Scientifiquement infondé
Régulièrement évoqué dans les médias ou les instances sociojudiciaires, le « syndrome d’aliénation parentale » (SAP) a été conceptualisé au milieu des années 1980 par le psychiatre américain Richard Gardner. Selon lui, il s’agit d’un « trouble de l’enfant, qui survient presque exclusivement dans des litiges relatifs à la garde des enfants, dans lequel un parent (généralement la mère) programme l’enfant pour qu’il déteste l’autre parent (généralement le père) ». Très controversé, tant pour ses méthodes non académiques que pour ses prises de position défendant la pédophilie, ce praticien estime que la majorité des accusations d’abus sexuels portées contre les pères sont fausses : d’après lui, elles sont presque toujours le fruit d’une manipulation de la mère, en vue d’obtenir la garde des enfants.
Une théorie contre laquelle s’élèvent depuis des années de nombreux·euses praticien·nes à travers le monde. Comme le psychiatre français Gérard Lopez, cofondateur de l’Institut de victimologie de Paris et ancien expert judiciaire : « Le syndrome d’aliénation parentale n’existe pas ! Bien sûr que, de temps en temps, un parent peut manipuler un enfant. Mais toutes les études montrent que les fausses allégations sont rares », soutient-il à Causette. Prenons l’enquête menée en 2005 au Canada par Nico Trocmé et Nicholas Bala, qui fait figure de référence. Sur plus de 7 600 signalements de mauvais traitements, elle dénombre 4 % de fausses allégations intentionnelles – presque toujours portées par des adultes. Détail intéressant : ces fausses accusations intentionnelles se révèlent plus fréquentes (12 %) lorsque les parents sont séparés… « mais sont plus souvent le fait de celui qui n’a pas la garde (généralement le père), pour 43 %, que de celui qui a la garde (généralement la mère), pour 14 % ».
Quid alors de la théorie de Gardner ? « Le syndrome d’aliénation parentale n’a fait l’objet d’aucune étude sérieuse et ne fait pas consensus au sein de la communauté médicale et scientifique. On est dans l’idéologie. C’est pour ça que le SAP n’a pas été intégré au DSM‑5 [la dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, de l’Association américaine de psychiatrie, ndlr] », pointe le Dr Gérard Lopez. Malgré ce qu’affirment nombre de groupes masculinistes, le syndrome d’aliénation parentale n’a pas non plus été reconnu par l’Organisation mondiale de la santé, qui ne l’a pas intégré dans le CIM-11 (la classification internationale des maladies) adopté en mai dernier. Ce qui n’empêche pas « l’aliénation parentale » de gagner en popularité, dans le monde judiciaire comme dans la classe politique.
Une notion en vogue
En France, entre 2009 et 2013, pas moins de trois propo-sitions de loi relatives au SAP ont été déposées à l’Assemblée nationale – sous couvert, toujours, de défendre l’égalité parentale. Des textes qui reprenaient quasi mot pour mot la rhétorique des militants de la « cause des pères », notamment celle de SOS Papa – cette association qui, l’an dernier, appelait ses membres à ficher les structures d’accueil pour femmes victimes de violences au motif qu’elles « discréditent les papas ». Dans leurs projets de loi, les député·es proposaient donc (en vain) de « créer un délit d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale », punissant d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende le parent jugé coupable de dégrader le lien avec l’autre. En 2013, c’est par le biais d’une question écrite à la garde des Sceaux qu’un nouveau député demandait, à son tour, la reconnaissance officielle du SAP. Rebelote en 2018, sous la plume d’un élu LRM, qui s’adressait cette fois-ci à la ministre des Solidarités et de la Santé.
Mais d’où vient cet intérêt soudain pour le SAP ? « Les associations de pères séparés font du lobbying depuis des années pour qu’il soit officiellement reconnu », avance le journaliste Patric Jean, qui s’apprête à publier un ouvrage sur le sujet, La Loi des pères (éd. du Rocher, janvier 2020). Dans leur bataille, ils peuvent d’ailleurs compter sur une poignée d’experts – toujours les mêmes – qui font allègrement la promotion du SAP. Parmi eux, le très médiatique Paul Bensussan, psychiatre et expert auprès des tribunaux, qui intervient régulièrement à l’École nationale de la magistrature. Souvenez-vous : c’est lui qui a pris la parole dans le procès d’Outreau à la demande de la défense pour contester la fiabilité des témoignages des enfants (qu’il n’avait jamais rencontrés et dont douze ont été reconnus victimes). C’est lui aussi qui dénonce « l’obsession de la maltraitance sexuelle ». Lui, encore, qui regrette que le viol conjugal soit considéré comme un viol, là où il ne voit qu’une « sexualité imposée » par un « conjoint indélicat ». Dans ses travaux, il se réfère souvent à Hubert Van Gijseghem, un psychologue belge installé au Québec qui, lors d’une audition devant le parlement du Canada, affirmait que la « pédophilie est une orientation sexuelle » comparable à l’hétérosexualité ou à l’homosexualité. Pour lui, d’ailleurs, il ne fait aucun doute qu’une « grande proportion » des allégations d’abus sexuels survenant dans des contextes de séparations « sont fausses » et souvent orchestrées par une mère à la « personnalité hystérique ». « En vingt ans, Hubert Van Gijseghem est intervenu environ cent vingt fois en France auprès d’associations de protection de l’enfance, de structures de travail social, mais aussi à l’École nationale de la magistrature », ont recensé les chercheur·euses Gwénola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent, qui ont par ailleurs fondé le Réseau international des mères en lutte.
Le SAP est utilisé pour masquer les violences sur les femmes et les enfants.
Françoise Brié, directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes
Pas surprenant, donc, que le concept d’aliénation parentale se soit largement diffusé auprès des magistrat·es et des professionnel·les du travail social. À tel point qu’en 2018, le ministère de la Justice a publié une note interne pour informer les magistrat·es du caractère « non reconnu » du SAP. Mais il n’a pas été jusqu’à proscrire son utilisation, comme le préconisait le 5e Plan de lutte contre les violences faites aux femmes (adopté en 2017). Lequel estimait que « dans les cas de violences conjugales ou de violences faites aux enfants, l’allégation du “syndrome d’aliénation parentale” soulève de réelles difficultés ».
Faire taire les victimes
Eh oui ! en dénonçant les violences de leur ex-conjoint ou, pire, en refusant que leurs enfants soient hébergés chez lui, les femmes prennent aujourd’hui le risque d’être accusées d’aliénation parentale. Ce dont témoigne Lya 1, qui a quitté son mari il y a près de trois ans, après une décennie de violences. « Je suis terrorisée par ce que ma fille me raconte lorsqu’elle revient de chez son père, mais je ne peux pas en parler à la juge. Si je lui dis qu’il la frappe, mais que je l’amène au droit de visite, je vais être accusée de ne pas la protéger. Mais si je ne l’emmène plus, je deviens coupable de non-présentation d’enfant. C’est un choix cornélien. Et les avocates que j’ai consultées m’ont toutes conseillé de ne pas en parler, car la parole de ma fille n’est pas suffisante. On va dire que je lui monte la tête », craint Lya. Et elle est loin d’être la seule dans ce cas.
En 2015, au Québec, le chercheur Simon Lapierre a mené une étude auprès de trente centres d’hébergement pour femmes victimes de violences. « Sur une période de cinq ans, certaines maisons ont identifié jusqu’à cinquante femmes qui avaient été accusées ou menacées d’être accusées d’aliénation parentale », note ce spécialiste, pointant un « phénomène qui prend de l’ampleur ». En France, Françoise Brié, directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère soixante-sept structures d’accueil pour femmes victimes, le constate aussi : « Le SAP est utilisé pour masquer les violences sur les femmes et les enfants. Nous, on est plutôt favorables à ce qu’elles signalent les violences – qui continuent après la séparation, notamment à travers les enfants. Mais c’est compliqué pour elles, car si elles portent plainte plusieurs fois pour les mêmes faits, elles passent pour des procédurières, et ça peut se retourner contre elles. » Jusqu’à, parfois, se voir retirer la garde de leurs enfants.
En 2018–2019, Gwénola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent ont mené une étude auprès de femmes accusées d’aliénation parentale 2. L’étude a révélé que ces accusations avaient lieu dans un contexte de violences conjugales, reconnues ou non par la justice. « Sur les treize femmes interrogées, quatre ont failli perdre la garde de leur(s) enfant(s) à la suite de ces accusations, et quatre l’ont perdue », résument-ils. C’est précisément ce qui est arrivé à Virginie, 43 ans, qui a quitté son conjoint en 2008 à la suite de violences. À l’époque, c’est elle qui a la garde de leur fille, et son ex-mari, un droit de visite et d’hébergement classique. Mais au fil du temps, la situation s’envenime : d’un côté, Virginie dit subir harcèlement et intimidations. De l’autre, sa fille dit ne plus vouloir aller chez son père – ce que confirment plusieurs attestations de témoins que nous avons pu consulter. « Souvent, il venait pour récupérer la petite, il criait, puis s’en allait sans elle et allait ensuite déposer plainte pour non-présentation d’enfant », soutient Virginie, qui sera condamnée en 2012 à trois mois de prison avec sursis pour une partie de ces plaintes. Et c’est là que son histoire prend une tournure ubuesque.
« Pour prouver [sa] bonne foi et mettre fin aux intimidations », Virginie saisit à deux reprises le juge aux affaires familiales pour demander la mise en place de visites médiatisées. Ce que refuse le magistrat, qui, sans la moindre expertise psychologique, conclut à un « syndrome d’aliénation parentale » et autorise le père à demander la garde de l’enfant, qu’il réclame. Quatre mois plus tard, c’est acté : la fillette déménage chez son père. Six ans plus tard, elle y réside toujours. L’an dernier, alors qu’elle avait 12 ans, elle a pourtant fugué de chez lui et a écrit au juge des enfants pour demander à retourner vivre chez sa mère. « Mais la justice estime qu’elle est prise dans un “conflit parental”. Malgré l’expertise psychologique (que j’ai demandée), malgré les preuves et les témoins, je n’arrive pas à me défaire de cette étiquette de “mère aliénante” », se désespère Virginie, qui vient de nouveau d’être déboutée de sa demande de résidence partagée. Et envisage désormais de se pourvoir en cassation.
1. Les prénoms ont été modifiés.
2. “How is Parental Alienation Used Against Separated and Divorced Mothers in France”, par G. Sueur et P.-G. Prigent. Communication présentée le 2 septembre 2019 à l’European Conference on Domestic Violence, à Oslo (Norvège).
Les arguments mascus passés au crible
“La justice favorise les mères”
Les pères séparés sont-ils discriminés par une « justice sexiste », comme l’affirme SOS Papa ? Selon le ministère de la Justice, la garde des enfants est effectivement accordée à la mère dans 71 % des cas et au père dans seulement 12 % des cas. Mais ce qu’oublie de préciser SOS Papa, c’est que si les pères sont peu nombreux à obtenir la garde de leur(s) enfant(s)… c’est qu’ils ne la demandent pas ! Selon cette même étude*, la décision du juge s’est révélée conforme à la demande des pères dans 93 % des cas. Et lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord (une situation sur dix), les enfants sont confié·es au père dans 24 % des cas… soit deux fois plus qu’en ‑l’absence de conflit.
* Réalisée en 2012 sur 6 042 décisions de justice.
“Les pères séparés se suicident en masse”
« Tous les ans, on a 1 300 pères séparés de leurs enfants qui se suicident », dénonçait encore récemment la présidente de l’association Forces laïques. Régulièrement brandi, ce chiffre a été établi par SOS Papa, à partir d’un article de 2005 d’Éric Verdier, psychologue et alors membre de l’ex-association Coparentalité. Ce dernier y expliquait avoir envoyé un questionnaire aux 209 président·es des tribunaux de grande instance et des cours d’appel. « Nous avons reçu… sept réponses », relate-t-il. Parmi elles, une magistrate évoquait « une soixantaine » de suicides, en majorité des pères, sur 8 000 procédures. Une unique estimation, que SOS Papa a ensuite extrapolée à l’ensemble des séparations avec enfants (175 000 par an), grâce à une bonne vieille règle de trois. De quoi faire dresser les cheveux sur la tête des statisticien·nes.
“Une femme battue sur deux est un homme”
« Les hommes violentés sont aussi nombreux que les femmes violentées », assurent nombre de groupes masculinistes, à commencer par le Groupe d’étude sur les sexismes (GES). Pour preuve, ce dernier cite notamment les études de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) : en 2015, 393 000 femmes et 175 000 hommes s’y déclaraient victimes de violences par un·e (ex)-partenaire. Une différence qui n’en est pas vraiment une, estime le GES, car « la plupart des femmes identifient le fait d’être “bousculées” à une violence, ce que ne font pas la plupart des hommes. […] Lorsque l’ONDRP aura ajusté sa méthodologie, les résultats pour les hommes ‑violentés devraient atteindre le même niveau que ceux obtenus pour les femmes ». Bah tiens ! En attendant, 81 % des victimes de meurtres conjugaux recensées l’an dernier sont bien des femmes.